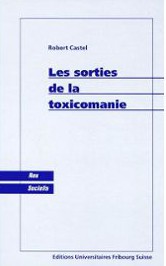- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
- Robert Castel
Post-face d’Anne Coppel sur le contexte de cette recherche :
Le rapport Trautmann, publié en 1989, se propose de reconstruire le consensus politique qui avait caractérisé la politique française (1). En avant-propos, Catherine Trautmann, rapporteur, reconnaît la gravité d’une menace qui risque de « faire basculer des États démocratiques dans la violence et la terreur » mais elle défend une politique qui a su conjuguer « efficacité et valeurs démocratiques ». Par valeurs démocratiques, le rapporteur réaffirme les principes constitutifs du système de soins français : volontariat, gratuité et anonymat. Ces principes avaient été acquis lors de la négociation de la loi de 1970. En échange d’une pénalisation de l’usage de drogue qu’ils ne souhaitaient pas, les soignants obtiennent un espace thérapeutique qui, avec le volontariat et l’anonymat, échappe au contrôle de la loi. Le pacte ainsi construit est progressivement intégré par les soignants. La loi de 1970 est d’abord considérée comme une concession purement symbolique à l’ordre moral. Mais peu à peu, ceux-ci découvrent la nécessité de l’interdit. Le cadre d’interprétation psychanalytique, de plus en plus prégnant avec le processus de professionnalisation de ce nouveau champ d’intervention, est invoqué et la Loi symbolique est appelée en renfort de la loi pénale. Dans le chaos primitif qui caractérise le toxicomane, incapable de différer la satisfaction de ses désirs, la loi introduit la frustration et, par là même, devient structurante : » Entre juges et médecins, un consensus existe aujourd’hui sur la notion de loi, à la fois point de repère et rappel du principe de réalité » écrit ainsi le rapport Trautmann.
Les concessions des professionnels de santé au dispositif répressif s’avèrent cependant insuffisantes. 1989 marque un tournant. Lors du sommet du G7, les américains appellent à une mobilisation internationale contre les trafiquants de drogue. François Mitterand est désormais convaincu de la nécessité d’un discours de guerre à la drogue. Le rapport Trautmann, au départ rédigé sous l’influence de spécialistes qui dénoncent l’idéologie du fléau, est infléchi dans ce sens : la guerre à la drogue triomphe. Tel est le contexte où l’Etat sollicite pour la première fois officiellement le milieu de la recherche avec la création de l’association Descartes en 1990.
La recherche sur les sorties de la toxicomanie a précédé de deux ans cette demande et elle a certainement contribué à légitimer l’appel aux chercheurs. Par son objet et par sa démarche, cette recherche se propose d’élaborer des outils conceptuels permettant de « Penser les drogues », pour reprendre le titre d’une des premières publications de l’association Descartes (2). Toutefois ce travail ne s’inscrit pas directement dans le débat ou plus précisément, il refuse les termes dans lesquels les spécialistes en toxicomanie entendent circonscrire le débat – car pour les spécialistes, le débat serait simple, il opposerait l’éthique du soin, définie par le volontariat et l’anonymat, aux tenants d’une société autoritaire. Au nom des valeurs démocratiques, une problématique médico-psychologique s’imposait sans discussion. La question des sorties spontanées de la toxicomanie impliquait le recours à d’autres théories explicatives. Observées dès les années 60 aux USA, les sorties spontanées avaient profondément ébranlé la définition médicale de la toxicomanie comme maladie chronique. En France, les spécialistes s’étaient démarqués de cette approche médicale, le débat ne portait donc pas sur la toxicomanie comme maladie chronique, théorie médicale qui n’était défendue par personne, mais les sorties spontanées remettaient en cause l’interprétation exclusive de la toxicomanie comme symptôme d’un manque originel. De retour du Viêt-nam, les GIs héroïnomanes avaient renoncé à leur toxicomanie le plus souvent sans traitement, et ce renoncement avait été mis en relation avec la nature de leur environnement. Pouvait-on décrire les stratégies de sortie au regard des réseaux de solidarité que le toxicomane pouvait mobiliser ? Cette question inscrivait la recherche sur les sorties de la toxicomanie dans le programme de travail du GRASS (3) portant à la fois sur les réseaux de sociabilité et sur les stratégies d’intervention.
La démarche que nous avons adoptée – rendre compte de la part de rationalité de l’acteur – n’a rien d’original au regard des travaux sociologiques de cette période. Dans le domaine de la drogue, ce parti pris prend le contre-pied d’un processus continu de stigmatisation qui a marqué les années quatre-vingt. Très influencés par les idéologies contestataires au début des années soixante-dix, les professionnels du soin avaient pris leur distance avec leurs patients. Le toxicomane, héros de la liberté au début des années soixante-dix, était devenu « toxico-dépendant ». Parce que le toxicomane a perdu le contrôle de sa vie, nombre de spécialistes s’opposent à la libéralisation des seringues: « quand on est prêt à jongler avec la prison, la folie et la mort, on peut tout autant jongler avec la mort » (4). Cette recherche ouvre à une approche moins mythologique et plus humaine de l’usager de drogues, comme s’il nous avait fallu lentement redécouvrir que le toxicomane était, sans doute, un être humain un peu comme les autres, aussi – ou aussi peu – rationnel. Il aura fallu la violence de l’épidémie de Sida pour nous rappeler qu’il avait, un peu comme les autres hommes, non seulement un esprit mais aussi un corps qu’il devait soigner et protéger. Au moment de l’élaboration de la problématique de la recherche, l’épidémie de Sida flambait et cette menace a certainement contribué à rendre plus actuelle ou plus urgente la nécessité du débat mais tel n’était pas notre objet. Nous avons donc choisi d’écarter provisoirement trois questions :
– la question du dispositif législatif, en France, avec la loi de 1970 et plus généralement du régime de prohibition ;– la question du Sida ;– la question de l’évaluation du système de soins.En posant l’usager comme acteur, en identifiant différentes stratégies de sorties, nous apportions une contribution au moins indirecte à chacune de ces questions. Il était clair, par exemple, que nous remettions en cause des représentations sociales de la toxicomanie issues du régime de prohibition des drogues. Mais il importait, à un moment où aucune de ces questions n’avait fait l’objet de recherches sociologiques en France, de construire d’abord des outils conceptuels, préalables à un questionnement rigoureux.
Nous avons écarté d’un commun accord la question du Sida. La menace du Sida modifiait peut-être les choix des usagers mais la problématique de recherche se situait en amont puisqu’elle portait sur les processus qui amènent l’usager à s’engager dans une stratégie ou dans une autre. La mise à distance de cette question était donc légitime au regard de notre objet de recherche. Il se trouve que le même raisonnement a justifié dans le domaine de l’intervention le statu quo de l’offre de soins. Toxicomanie et Sida ont été soigneusement différenciés. La toxicomanie ne relevait pas des compétences des services publics qui avaient en charge la prévention ou le soin du Sida tandis que le traitement des toxicomanes devait poursuivre son œuvre, avec ou sans Sida. Nous n’avons pas imaginé que la menace du Sida puisse faire basculer la conception même du soin. Je dirais plus précisément que, jusqu’en 1992, je ne l’ai pas imaginé, tandis que les spécialistes en toxicomanie ont consacré toutes leurs forces à maintenir le système en l’état au nom du refus de la dramatisation: il ne fallait pas céder à la panique, il ne fallait pas « se laisser intoxiquer par le Sida ». Devait-on engager des désintoxications de patients condamnés par la médecine ? Invoquant la déontologie médicale, des cliniciens, parmi les meilleurs, ont eu à cœur de poursuivre leur prise en charge et non d’abandonner le patient sous prétexte qu’il était malade. La position de principe, irréprochable, laisse toutefois dans l’ombre la nature de la prise en charge, qui ne se concevait que dans un objectif de sortie de la toxicomanie.
Le refus de « l’amalgame toxicomanie/Sida » a été collectif, des praticiens aux chercheurs, en passant par les décideurs et les médias, avec chaque fois un argumentaire légitime au regard des objectifs et des pratiques de chacun. Qu’aurait impliqué la prise en compte du Sida dans la recherche ? Aux USA, en Grande-Bretagne, des chercheurs se sont engagés dès 1985-1986 dans des recherches portant sur le changement de comportement des toxicomanes. Les toxicomanes qui se droguent peuvent-ils, veulent-ils se soigner, peuvent-ils se protéger de la maladie ? Ces recherches ont été à l’origine d’un profond changement de perspective. Poser la question des changements de comportements des toxicomanes c’est accepter l’usage de drogues, alors que tous les dispositifs d’intervention ont pour unique objectif l’arrêt des drogues. Tout comme les sorties de la toxicomanie, le changement de comportement des toxicomanes actifs impliquait de faire appel à la part de rationalité de l’acteur et à son inscription dans des réseaux de sociabilité. À cet égard, nous pouvions choisir indifféremment l’une ou l’autre question. Nous avons choisi l’une, nous n’avons pas songé à l’autre.
Une seule des trois questions qu’il nous avait semblé nécessaire d’écarter a resurgi très régulièrement au sein du groupe de recherche parce que le déroulement des enquêtes de terrain n’en permettait pas l’économie, la question de l’évaluation du système de soins. Nous avions décidé d’aller rechercher les toxicomanes là où nous pensions pouvoir les trouver : par les différents professionnels, services, institutions ou organisations qui prétendent à leur prise en charge ou encore par réseaux interpersonnels, pour ce qui concerne ceux qui n’ont pas eu recours au système de soins spécialisés. Nous avons donc retenu ce qui nous semblait être les principales réponses françaises, soit les institutions de soins spécialisés avec mission de service public, soit celles relevant d’institutions « profanes » comme le Patriarche et Narcotiques anonymes. Le choix lui-même appelle plusieurs discussions. La première porte sur l’inclusion de toxicomanes issus du Patriarche. Nous étions tout à fait conscients d’aller à l’encontre de l’anathème lancé par le système de soins spécialisés. En aucune manière, il ne s’agissait de justifier des traitements fondés sur une idéologie autoritaire mais il importait de surmonter l’interdit de penser que justifiait l’amalgame entre méthode de traitement (communauté thérapeutique) et idéologie autoritaire. Car il y avait bien interdit de penser. Autre discussion, l’exclusion des traitements par la méthadone, exclusion parfaitement justifiée au regard du petit nombre de patients mais ce choix confortait de fait le consensus idéologique qui excluait la méthadone comme traitement. Au cours de la recherche, j’ai participé à l’ouverture d’un programme méthadone mais j’ai tenu cette pratique clinique à l’écart du questionnement de la recherche. Je considérais que la prise en compte de ce traitement médicalisé n’était pas déterminant dans notre problématique. Je savais que les usagers de drogue utilisaient largement des produits légaux, la codéine en particulier, en substitution de l’héroïne. Mais cette utilisation n’avait pas alors pour moi le statut de traitement, je la considérais comme une ressource autogérée, que je me proposais de décrire dans les entretiens avec les usagers de drogues. Ces pratiques de consommation ont donc été signalées dans le travail d’enquête, sans y attacher une signification particulière.
Nous avons très vite été confrontés à des problèmes de recrutement très inégaux selon les institutions et difficilement comparables. Nous avons eu ainsi la plus grande difficulté à entrer en relation avec des usagers de drogues qui s’en étaient sortis par les institutions de soins classiques. Nous avons renoncé à rendre compte des difficultés que nous avons rencontrées, difficultés qui nécessitaient de mener le débat sur le terrain des méthodes de soin, terrain où nous n’avons pas voulu nous aventurer. Il était clair que les toxicomanes qui revendiquaient s’en être sortis par le chemin qui leur était proposé dans les institutions de soins classiques étaient, si ce n’est inexistants, du moins peu nombreux. Aujourd’hui, la question du système de soins est posée publiquement. Le diagnostic de la commission Henrion, réunie en 1994 à la demande de Simone Veil, alors ministre de la Santé est clair. Il dénonce et illustre précisément « l’indifférence au réel », « le décalage entre les discours et les faits » qui caractérise la mise en œuvre de la politique de lutte contre la toxicomanie et concernant spécifiquement l’offre de soins « l’indigence masquée par le prestige intellectuel de certains de ces intervenants ( … ) laissant à beaucoup de citoyens l’impression d’une politique équilibrée » (5). Mais en 1988, les intervenants en toxicomanie mobilisent encore toutes leurs forces pour neutraliser toute tentative d’évaluation comme ils le reconnaissent aujourd’hui.
Rétrospectivement, on peut s’étonner, voire se scandaliser, du refus collectif de nous affronter aux questions centrales du débat sur les drogues. À l’époque, c’est- à-dire en 1988, je n’étais pas engagée, comme je le suis aujourd’hui, dans une réforme que je n’imaginais pas possible. Il me semblait au contraire que la question des drogues était par excellence une de ces questions où les pesanteurs idéologiques étaient telles qu’elles rendaient tout changement immédiat proprement inimaginable. Le débat sur le système de soins spécialisés se serait-il ouvert plus précocement si nous avions présenté nos résultats et nos difficultés ? Il est bien sûr impossible de le dire.
Le débat public s’est ouvert peu après, précisément en septembre 1992, et il ne s’est pas ouvert sur des questions idéologiques mais à partir de pratiques innovantes, marginales, voire illégales. Quelques médecins généralistes et spécialistes du Sida avaient été amenés à prescrire des produits de substitution à la demande de leurs patients. Cette pratique, condamnée par la médecine officielle et honnie par les spécialistes, commençait à prendre de l’ampleur. Les médecins avaient pu constater l’amélioration de leurs patients mais plus cette demande leur semblait légitime, plus elle progressait. Débordés, et de plus en plus convaincus de la nécessité de ces traitements, ces médecins ont fait appel publiquement à leurs collègues dans un article du journal Le Monde publié le 9 septembre 1992. En quelques mois, une prise de conscience collective a mené à un bouleversement des pratiques, des problématiques et des stratégies d’intervention. Tardivement au regard des pays européens, les politiques de « réduction des risques » (6) se sont introduites en France. Bon gré mal gré, il nous fallait apprendre à coexister avec les drogues.
La petite révolution culturelle qui a agité les réformateurs dont je suis, a encore peu de prise sur la société et la drogue reste avant tout – tant dans les représentations que dans les réponses – un problème de sécurité publique. Quelques mesures de santé ont été prises à la hâte mais la politique française de lutte contre la toxicomanie ne s’est pas modifiée pour autant. Tout fonctionne comme si ces mesures pouvaient se surajouter au dispositif actuel sans en modifier l’équilibre général, alors que, comme le font remarquer à juste titre ses adversaires, les politiques de réduction des risques ne sont pas conciliables avec un objectif d’éradication des drogues. Nous sommes encore très loin d’un changement de politique de lutte contre la drogue mais du moins, les politiques de réduction des risques ont-elles imposé un changement de perspective. Ainsi les questions qui peuvent aujourd’hui être considérées comme légitimes dans le champ de la recherche ont changé. Henri Bergeron vient de terminer une thèse de sociologie sur l’histoire du dispositif français de soins aux toxicomanes (1970-1995) (7). Sa question porte sur les processus sociaux de maintien de l’arbitraire thérapeutique français : comment expliquer qu’une part des soignants « pas plus déraisonnables que n’importe qui, par hypothèse » ait attendu si longtemps pour prendre en compte la santé des personnes qu’ils prétendaient protéger ? A minima, pourquoi s’être refusé avec tant de passion à prescrire à des malades des traitements dont on sait qu’ils soulagent la souffrance et qui – l’expérience l’a démontrée – réduisent la mortalité ? Henri Bergeron retient plusieurs hypothèses, dont la sélection des toxicomanes par le système de soins, excluant les plus malades et les plus marginaux. Pour ma part, je retiens comme déterminante une autre des hypothèses formulées par ce chercheur : la non-visibilité des toxicomanes les plus dégradés est d’abord un effet du cadre cognitif qui, en l’absence d’une alternative, interdit de voir ce qui ne peut être pris en compte. Dans le centre de soins où je travaillais, dans les enquêtes de terrain que j’ai menées, j’ai vu des toxicomanes très marginalisés et malades du Sida mais j’ai accepté les règles institutionnelles de mon cadre de travail qui imposaient de refuser toute prise en charge de toxicomanes qui poursuivaient leur intoxication. Je l’ai fait du mieux que j’ai pu, en tentant d’adapter mes réponses aux marges du système, j’ai refusé le système de rationalisation faisant porter exclusivement sur le toxicomane la responsabilité de son exclusion du système de soins, mais travailler avec une institution – il en est de même pour l’école ou pour l’hôpital – implique une adhésion, même a minima, à des cadres collectifs d’interprétation.
Henri Bergeron analyse fort justement comment les positions des acteurs de terrain trouvaient son prolongement « dans les catégories cognitives et l’architecture de l’administration ». Je dirai en guise de conclusion que le système de soins français avait réussi le tour de force de convenir à tout le monde. Avec un discours des droits de l’homme, dénonçant le contrôle social et le contrôle médical, au nom de la liberté, le système de soin confortait de façon paradoxale mais parfaitement efficace le dispositif de lutte contre la drogue le plus répressif d’Europe. J’ai tenté d’analyser depuis, comment pour « entendre la douleur de la personne toxicomane » les soignants se sont refusés à la soulager, comment la dénonciation du contrôle social a contribué à renforcer les contrôles répressifs, comment au nom de la liberté du toxicomane lui a été refusé la liberté de choisir son traitement, comment « l’approche globale de la personne » a évacué également besoins sociaux et besoins sanitaires du toxicomane, en pleine épidémie de Sida » (8). Pour ébranler ces croyances collectives, il nous aura fallu confronter systématiquement les pétitions de principe avec ce que nous constations sur· le terrain. La formulation même de ces constats de terrain a exigé de passer au crible nos propres croyances, fondement de notre adhésion – si partielle était-elle – au consensus français. Il nous aura fallu, particulièrement, hiérarchiser les débats. En pleine épidémie de Sida, alors qu’une part alarmante des toxicomanes étaient rejetés des hôpitaux comme des cabinets de médecine générale, le débat idéologique sur la médicalisation des toxicomanes ne devait pas conforter ou justifier le refus de prise en charge des malades du Sida. Dans ce contexte, la priorité est l’implication des médecins. Ce qui ne signifie pas pour autant renoncer à toute réflexion sur le pouvoir médical, mais le renouveau de la santé publique, du Sida aux vaches folles, impose un renouveau de la pensée.
La recherche sur Les sorties de la toxicomanie a précédé de peu le mouvement de réforme sociale qui a porté les politiques de réduction des risques liés à l’usage de drogues. Cette recherche a contribué à penser la question de la drogue hors du cadre clinique. Les timidités ou les silences témoignent de la difficulté à sortir des cadres de pensées communément admises. Le changement d’un système de croyance ne se fait pas n’importe comment, il obéit à des règles qui sont du reste un des objets de la sociologie.
BIBLIOGRAPHIE
1. TRAUTMANN C., Lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants, Paris, La Documentation française, 1989.
2. EHRENBERG A. (sous la dir. de), Penser la drogue, penser les drogues, Paris, Editions Descartes, 1992.
3. Groupe de recherche et d’analyse du social et de la sociabilité, Unité de recherche associée – Centre national de recherche scientifique et Université de Paris VIII.
4. Citation du Docteur Francis CURTET, membre de la Commission des stupéfiants, justifiant le maintien de l’interdiction de la vente libre des seringues, Quotidien du Médecin, 3 mars 1986.
5. Rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, sous la présidence de HENRION R., Ministère des Affaires sociales et de la ville, 1995.
6. Traduction imprécise de l’anglais « Harm Reduction for Drug Users » qui signifie « réduction des dommages et violences que subissent les usagers de drogues » .
7. BERGERON H., Anatomie d’une croyance collective. Analyse historique du champ du soin de la toxicomanie en France, ou l’histoire de la domination d’un paradigme, thèse pour l’Institut d’études politiques de Paris, mention sociologie, 1997, 412 p.
8. COPPEL A., « Les intervenants en toxicomanie, le sida et la réduction des risques en France » in Communications, Vivre avec les drogues, n°62, 1996.