- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
Lewin, son auteur, y tente – et c’est le premier ouvrage de ce type – une description exhaustive des différents usages de ces curieuses substances, « excitant artificiel du cerveau» : « L’homme les utilise au fond des forêts primitives, sous la hutte de feuillage ( … ) les hommes les utilisent dans la splendeur de la civilisation ( … ) chez les uns, elles éclairent la plus profonde nuit des passions avec les impuissances morales, chez les autres, elles accompagnent les heures de joie les plus extensivement claires, les états les plus heureux du bien-être moral ou de la sérénité. » Tout a été dit, semble-t-il, sur ces substances magiques que consomment également « l’ouvrier prisonnier de la loi d’airain du travail ( … ), l ‘homme libre de tout souci alimentaire ( … ), le sauvage habitant de quelque île lointaine ou la forêt du Congo ( … ), mais aussi les poètes, les penseurs, les graves hommes de science, le réformateur et le misanthrope (1) ».
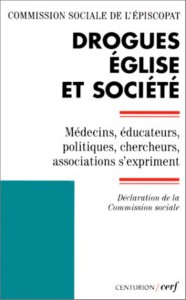 Ouvrages scientifiques ou conférences grand public s’ouvrent également par ce rappel, mille fois répété : «De tous temps, dans toutes les sociétés, les hommes ont consommé des drogues. » Mais si les hommes ont bien consommé ces substances, l’invention du concept de « drogue » a profondément modifié la signification de ces consommations. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les hommes de science regroupent sous un même terme ces « poisons de l’esprit » qui les ont d’abord fascinés puis terrorisés. À ce titre, l’histoire des drogues commence il y a à peine plus d’un siècle. Pendant des millénaires, nous avons coexisté avec ces substances qui sont brutalement devenues le fléau social par excellence. Comment a émergé ce problème qui, pour une part non négligeable de l’opinion publique, est devenu un sujet de préoccupation majeure ? Quels sont les effets de cette guerre à la drogue dans laquelle nous nous engageons chaque jour davantage ? Pouvons-nous gagner la guerre contre la drogue ou sommes-nous condamnés à la mener sans relâche ? Peut-on enfin imaginer une alternative à la guerre ?
Ouvrages scientifiques ou conférences grand public s’ouvrent également par ce rappel, mille fois répété : «De tous temps, dans toutes les sociétés, les hommes ont consommé des drogues. » Mais si les hommes ont bien consommé ces substances, l’invention du concept de « drogue » a profondément modifié la signification de ces consommations. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les hommes de science regroupent sous un même terme ces « poisons de l’esprit » qui les ont d’abord fascinés puis terrorisés. À ce titre, l’histoire des drogues commence il y a à peine plus d’un siècle. Pendant des millénaires, nous avons coexisté avec ces substances qui sont brutalement devenues le fléau social par excellence. Comment a émergé ce problème qui, pour une part non négligeable de l’opinion publique, est devenu un sujet de préoccupation majeure ? Quels sont les effets de cette guerre à la drogue dans laquelle nous nous engageons chaque jour davantage ? Pouvons-nous gagner la guerre contre la drogue ou sommes-nous condamnés à la mener sans relâche ? Peut-on enfin imaginer une alternative à la guerre ?
Avant que les drogues ne soient des drogues
De la coexistence ancienne des hommes avec les drogues, nous gardons peu de traces. Il faut à l ‘historien une patience infinie pour retrouver les traces de l’opium dans la France classique, alors que l’opium était la seule médecine efficace contre la douleur, qu’en étaient connus l’usage et ce que nous pouvons considérer comme l’abus. L’opium n’était guère plus présent dans les écrits que l’aspirine ne l’est aujourd’hui dans la littérature ; il surgit au hasard des confidences, lettres de Mme de Sévigné ou historiettes de Tallemant des Réaux. Introduit en Europe à la fin de l’époque médiévale, l’opium est utilisé comme thérapeutique, usage hérité de la médecine arabe et, avant elle, de la médecine hippocratique. Dans cette fonction médicinale, l’usage a pu en être très répandu ; il pouvait être quotidien, sans autre signification que le soulagement des petites ou grandes douleurs que l’homme doit affronter au jour le jour. Fonctionnel, l’opium s’intègre aux pratiques sociales ordinaires, sans susciter enthousiasme ou rejet. « La règle la plus générale, écrit l’anthropologue Blum décrivant l’usage de l’opium dans l’Inde pré-coloniale, est celle du désintérêt. »
Si l’opium a pu être à la fois fonctionnel et banal, il a aussi – et d’abord – été investi d’une puissance magique. Usage thérapeutique et rites religieux ont été longtemps étroitement associés. Nous avons appris à distinguer science, religion et magie, et ces différenciations ont profondément modifié la façon dont nous vivons aussi bien les sensations que la vie spirituelle, la souffrance, la mort ou le plaisir. Au contraire de nos sociétés qui distinguent le médicament de la recherche du plaisir, dans les sociétés traditionnelles, la souffrance s’apaise naturellement dans la joie. L’ivresse de l’opium était connue et recherchée quatre mille ans avant Jésus Christ et cette plante, appelée dans les tablettes sumériennes « la plante de la joie », était utilisée dans des cérémonies religieuses. Les propriétés hédonistes de l’opium étaient également connues des Égyptiens. Privilège des pharaons, l’opium a aussi pu être consommé collectivement lors du culte d’Osiris qui, selon Plutarque, livre la ville « aux excès des femmes et à la lie du peuple (2) ».
Des premières traces de l’opium, quelque 5 000 ans avant Jésus Christ, à l’Empire romain, le bassin oriental de la Méditerranée a expérimenté différents types d’usage, de celui hautement ritualisé, réservé aux initiés à un usage individuel laïcisé, qui donne le rêve et l’oubli à l’hôte qu’on accueille. Déméter mêle dans sa gerbe les épis de blé et les têtes de pavots. Mais Hélène, accueillant le fils d’Ulysse, lui offre, avec le népenthès, «une drogue endormant toute colère et toute peine », où, sans doute, le vin était mêlé à l’opium (3). Des dangers de l’opium, l’Antiquité ne retient que l’empoisonnement. Seul le vin a suscité des débats. Dionysos-Bacchus est un étranger que les Athéniens décident d ‘honorer plutôt que de proscrire. Et Platon, dans le Banquet, prend sa défense en ces termes : « Ne vilipendons pas le présent de Dionysos en prétendant qu’il s’agit d’un cadeau empoisonné qui ne mérite pas qu’une république accepte son introduction ( … ) Il suffira qu’une loi interdise aux jeunes de goûter le vin avant dix-huit ans et impose à l’homme de moins de trente ans d’y goûter de manière mesurée, en évitant absolument de s’enivrer par excès de boisson. » Et Platon de réserver l’ivresse aux hommes d’un certain âge, « remède aux rigueurs de la vieillesse », «pour nous rajeunir », car il peut être bénéfique « de céder à l’ivresse une ou deux fois de temps en temps» comme le recommande Hippocrate.
Au-delà du rejet des drogues, le monde moderne trouve suspecte toute modification des états de conscience. L’extase ou l’illumination sont volontiers interprétées comme les symptômes d’une pathologie mentale. Quant à l’ivresse, au mieux, elle prête à rire, mais plus souvent, elle provoque dégoût et opprobre y compris lorsqu’il boit, l’homme moderne doit faire la preuve de sa capacité de contrôle. « Savoir boire », c’est se battre contre sa propre ivresse. Les sociétés traditionnelles ont au contraire cultivé les différentes techniques qui modifient l’état de conscience tel le jeûne, la solitude, l’absorption dans une tâche, mais aussi l’ivresse, techniques qui ouvrent un chemin vers la divinité. Comme l’opium, les boissons fermentées, le tabac, les champignons hallucinogènes, la feuille de coca ou le chanvre ont été au cœur de rituels qui permettaient de communiquer avec les esprits. Pour Peter Furst, qui a décrit l’usage rituel de psychédéliques dans la culture amérindienne, il s’agit là d’une «des expériences fondatrices de la culture humaine » dont les premières traces remontent à plus de 10 000 ans, et qui sont passées du chamanisme mésolithique et paléolithique du vieux continent au chamanisme du nouveau monde (4).
Des années 50 aux années 60, un mouvement culturel revendique l’usage des drogues qui élargissent le champ de la conscience, à la découverte d’une vérité individuelle qu’une société normative tend à étouffer. Dans les sociétés qui usent rituellement de drogues psychotropes, le voyage dans « l’autre monde » fait expérimenter concrètement la réalité des mythes qui soudent la collectivité. L’Indien Huichol qui fait usage de peyotl fait vivre en lui tel esprit animal et atteste ainsi la toute-puissance des croyances qui lui ont été transmises. Ainsi étaient réaffirmés les liens de l’individu au groupe, la perte du contrôle de soi relevant d’une expérience religieuse étroitement codifiée.
Le concept de drogue s’est forgé dans une série de grandes mutations culturelles qui définissent l’individu moderne dans son rapport à lui-même et à la société. Mais les drogues modernes ont aussi une histoire qui leur est propre (5). Première étape dans la construction du concept de drogue : l’invention de nouveaux produits.
L’invention de nouveaux produits
L ‘histoire des drogues commence en effet au tout début du XIXe siècle avec la découverte des alcaloïdes. En rupture avec les usages traditionnels des plantes psychotropes, la science moderne va mettre à la disposition des médecins des produits chaque jour plus efficaces et plus puissants. La morphine est la première de ces inventions. En 1803, puis en 1804, deux Français isolent le sel de morphine mais c’est un Allemand, Friedrich Sertüner, qui mènera à son terme l’analyse de l’opium. Il parvient à isoler un alcali qu’il expérimente sur lui-même et trois de ses amis. Mal leur en prend. Tous trois sont victimes d’une violente intoxication et Sertüner en conclut que « la morphine agit comme un poison redoutable ». Malgré cet échec, Sertüner poursuit ses expérimentations et en paye lourdement le prix. Le premier d’une longue série d’expérimentateurs, il devient morphinomane et meurt, ruiné et abandonné de tous. En 1848, cinq ans après sa mort, l’Union pharmaceutique allemande reconnaît enfin l’intérêt de sa découverte. Un billet de banque est émis à son nom avec cette inscription : « Ta maison s’écroule, ta tombe est abandonnée mais ton œuvre perdurera tant que la terre tournera. »
Il faudra attendre l’invention de la seringue hypodermique vers 1850, puis la mise au point d’une technique de l’injection morphinique quelques années plus tard par Alexander Wood pour que les médecins comprennent l’utilité de la morphine. Dès lors, c’est l’enthousiasme: la douleur est enfin vaincue. « Il n’y a pas de procédé en médecine qui ait connu une popularité aussi rapide, pas de méthode qui soulage plus rapidement et plus durablement la douleur, pas de programme thérapeutique qui ait été utilisé avec aussi peu de précautions, pas de découverte thérapeutique qui ait causé à l’humanité un dommage plus durable que l’injection de morphine », écrit Kane en 1880, dans un des premiers ouvrages qui relate l ‘histoire de l’injection hypodermique de morphine.
Une fabrication et une distribution industrielles
Deuxième facteur qui a contribué à l’émergence du concept et du problème de la drogue : la naissance de l’industrie pharmaceutique. En dix ans à peine, grâce à l’industrie pharmaceutique, la morphine va conquérir le monde. Paracelse, à la fin de l’époque médiévale, avait inventé une potion miraculeuse à base d’opium dont la recette est transmise de maître à élève, dans le secret des officines. La diffusion se fait lentement jusqu’à ce que, vers les années 1660, le Dr Sydenham en Angleterre en simplifie la fabrication. Le laudanum commence alors une carrière fulgurante. Mais il faut attendre la naissance de l’industrie pharmaceutique pour que le produit soit standardisé, répété à volonté et distribué massivement. La morphine est née avec la pharmacie de Merck, qui passe d’une fabrication artisanale à une fabrication industrielle. Les procédés de la distribution industrielle accompagnent cette fabrication.
Les guerres, celle de Sécession aux États-Unis, la guerre franco-prussienne de 1870 en Europe, ont été des étapes décisives. Dans les hôpitaux de fortune, où s’entassent à même le sol blessés et agonisants, au lieu des cris et des gémissements, soudain règne « un calme étrange » : la morphine, utilisée sans restriction, a réussi ce miracle. De retour chez eux, certains patients continuent de réclamer leur médicament. Des médecins américains relèvent cette bizarrerie de comportement, bientôt identifiée comme « la maladie du soldat» (army disease). Mais déjà, le médicament commence à échapper au monde médical. Des réclames envahissent les journaux, qui vantent le miracle de la science. Lorsque l’enthousiasme des médecins fait place à la méfiance, de nouveaux produits prennent la relève. La cocaïne, dont l’alcaloïde a été isolé en 1859, fait rapidement des adeptes. Mêlée à du vin par Angelo Mariani, préparateur en pharmacie, elle séduit les hommes les plus influents. Le pape Léon XIII, le tsar de Russie, Jules Verne, Émile Zola, Colette, Thiers, Gambetta, tous témoigneront dans l’Album Mariani des propriétés miraculeuses de cette boisson stimulante, « arbre de la science et fleur de la bonté ».
La naissance d’une imagerie
L’enthousiasme des premiers temps fait sourire aujourd’hui. Nous y déchiffrons l’illusion même de la drogue, mais il aura fallu pour la morphine quelque cinquante années, dont quinze années d’utilisation médicale intensive, de 1870 à 1885, pour que le mythe se retourne, du médicament miracle aux imageries de la diabolisation. Un conte fantastique de Stevenson, Le cas étrange du Dr Jekyll et Mr Hyde, illustre ce retournement. La bonne médecine, « God’s own medecine », le médicament que Dieu lui-même utilise, est devenue une arme dangereuse qui se retourne contre son utilisateur. « À l’ombre de la Civilisation et du Progrès », écrit en 1891 le Dr Guimbail, la décadence menace.
À la fin du XIXe siècle, imagerie de la décadence et imagerie de la drogue sont étroitement associées. L’histoire de cette imagerie commence avec les poètes romantiques. Explorateur d’une nouvelle sensibilité, le mouvement romantique s’empare de tous les excitants de l’esprit. Parmi ces excitants, les drogues de l’ailleurs qui ouvrent une porte interdite, celle de l’imagination. Un Anglais, Thomas de Quincey, avait été le premier de ces explorateurs maudits ; le premier, il décrit la libération de l’esprit et son aliénation (6). Son livre est traduit en France par Alfred de Musset, et lu passionnément par Baudelaire, mais c’est la génération des décadents des années 1890 qui va véritablement illustrer l’engrenage diabolique. Dès les années 1880, la morphine sort du cabinet du médecin, le Tout-Paris est pris d’une passion frénétique. La morphine est partout, un véritable culte lui est rendu. Les esthètes décadents s’en emparent. Mais cette fois, les paradis artificiels n’ouvrent pas sur un ailleurs mythique conduisent inéluctablement à la mort. Les artistes prendront lentement leurs distances avec les produits en traversant, par différents chemins, cette Crise de civilisation qui a engendré, à la fin du siècle, la fascination étrange de la décadence.
L’internationalisation des échanges
Dans les représentations sociales, drogues et médicaments sont aujourd’hui tout à fait dissociés. Nous avons oublié que la morphine, l’héroïne ou la cocaïne ont été d’abord des médicaments, et cette amnésie collective frappe les médecins eux-mêmes, comme en témoigne la sous-utilisation médicale de la morphine en France. Dans les représentations, la drogue a désormais partie liée avec l’étranger. L’héroïne vient d’Asie du Sud-Est, la cocaïne d’Amérique latine et le cannabis d’Afrique, tandis que nous soupçonnons les minorités ethniques d’en être les vecteurs. Aux États-Unis, cette représentation est constitutive du problème de la drogue. Interdire l’opium, c’était, pour les syndicats d’ouvriers blancs du début du xxe siècle, se protéger contre la main-d’œuvre chinoise. De fait, pour une part, la confrontation brutale des cultures et des produits qui leur sont associés est bien à l’origine des intoxications collectives qui, dès le milieu du XIXe siècle, sont assimilées à des épidémies. La première des épidémies, la plus grande aussi, c’est l’épidémie d’opium en Chine.
Pour les Occidentaux, le mal est asiatique. Tandis que les armées coloniales exportent avec elles l’alcool, drogue traditionnelle de l’Occident, elles ramènent en France l’opium que nos armées coloniales ont appris à fumer en Indochine. Au tout début du xxe siècle, des fumeries d’opium s’ouvrent dans les ports tout d’abord, puis gagnent Paris. Des officiers de marine, Pierre Loti ou Victor Segalen, voient dans l’opium les clés de la pensée de l’Orient et partent à la recherche de la sagesse ancestrale de ce continent qu’ils viennent de conquérir. Mais ils semblent ignorer que les fumeries d’opium qu’ils ont fréquentées en Asie ont été imposées par les Européens, les armes à la main.
Car les fumeries d’opium n’ont rien de traditionnel en Asie. Le Céleste Empire connaissait un usage traditionnel de l’opium mais cet opium, principalement médicinal, était avalé. Au cours du XVIIe siècle, les marins hollandais introduisent en Asie un opium fumé avec du tabac et cette nouvelle forme d’usage transforme le produit en pure jouissance, et suscite aussitôt l’inquiétude du pouvoir. En 1729, l’empereur Yong Tchen prend la première mesure de prohibition : l’opium est interdit. Les entrepreneurs anglais n’en ont cure. Pour acquérir thé et soieries qu’ils vendent en Europe, ils développent la culture intensive de l’opium en Inde et se lancent dans le marché noir. 60 kg sont débarqués en contrebande en 1729, 4 000 kg en 1792, 6 000 kg en 1817. Puis, c’est l’escalade. En 1838, les importations ont été multipliées par six. À deux reprises, en 1838 puis en 1856, la Chine tentera de se protéger. À deux reprises, la Grande-Bretagne finance des interventions militaires connues sous le nom de « guerre de l’opium» Au nom du libre échange, l’Empire britannique impose le commerce de l’opium à la Chine. La Chine doit plier, elle s’ouvre au commerce international et le poison des « barbares étrangers » s’impose. À la fin du XIxe siècle, ce commerce aura engendré la plus grande épidémie de tous les temps : selon certains historiens, un Chinois sur dix serait opiomane, soit quelque 100 millions d’opiomanes.
La naissance d’un dispositif de contrôle
En Europe, la morphine, la cocaïne et l’héroïne sont des médicaments dont le contrôle revient légitimement aux professionnels de la santé, médecins et pharmaciens. Les médecins observent bien «une demande artificielle » induite par la consommation de morphine, mais « la faim de morphine », décrite dès 1870, est interprétée comme le symptôme d’une maladie. L’alcoolisme, dont le terme est inventé en 1849 par un médecin suédois, Magnus Huss, est le modèle de référence. Entre 1880 et 1890, les symptômes de cette curieuse maladie sont décrits par différents cliniciens, Levinstein et Lewin en Allemagne, Pichon, Chambard et Magnan en France. Considéré d’abord comme un empoisonnement, le « morphinisme » fait place à la « morphinomanie », rattachée aux passions pathologiques que traitent les aliénistes. Des thérapies sont expérimentées, de la recherche du contrepoison – la cocaïne est utilisée un temps dans cet objectif – aux différentes techniques de sevrage en passant par les premières psychothérapies et le traitement moral.
Les résultats s’avèrent décevants, la maladie semble bien incurable. Mais les médecins s’engagent dans un nouveau combat : protéger la santé publique. Au-delà du traitement, le médecin doit veiller à l’hygiène : hygiène des corps, hygiène de vie où la morale trouve un fondement scientifique. Réglementation, éducation et réforme sociale sont les trois armes de l’hygiène publique. Dans une alliance avec l’État, les médecins hygiénistes dénoncent les dangers, comptabilisent les malades, mettent en place des cordons sanitaires et s’engagent dans la lutte contre les grands fléaux sociaux, l’alcoolisme, le mal vénérien, les maladies de poitrine. Les drogues tiennent une place modeste dans cette lutte mais les armes sont les mêmes : moralisation et formation des professions médicales, réglementation des produits, éducation. Les premières mesures portent sur le contrôle des préparations et la formation d’un corps d’inspection des pharmacies. Du côté des médecins, les hygiénistes comme le Dr Brouardel font appel à leur responsabilité professionnelle : la morphine doit être utilisée parcimonieusement, la piqûre doit être faite par le praticien et non par le malade et le Dr Brouardel préconise au début des années 1880 l’utilisation d’ordonnances portant le nom et l’adresse du médecin.
La Grande-Bretagne avait inauguré cette nouvelle stratégie dès le milieu du XIXe siècle pour faire face à des consommations extensives et incontrôlées d’opium. En France, la révolution industrielle s’est accompagnée d’une montée de l’alcoolisme que dénoncent les médecins hygiénistes: les ouvriers boivent sans retenue le vin et les alcools forts, qui font supporter le dénuement et la dureté des conditions de travail. En Angleterre, le vin et le gin coûtent cher, sous la pression des premières ligues contre l’alcool. L’opium en revanche est largement accessible. Des Indes où il est cultivé, il envahit l’Angleterre sans restriction. Depuis le laudanum de Sydenham, de l’opium est mêlé à toutes les boissons fortifiantes que vendent aussi bien les pharmacies que les drogueries. Les mineurs en consomment dès le matin, avant de descendre à la mine, on en donne aux enfants pour les empêcher de pleurer. Dans les grandes enquêtes sur la condition ouvrière de 1840 et de 1842 comme dans l’enquête de Engels en 1848, ces consommations sont décrites et dénoncées. Des morts d’enfants attirent l’attention. Elles sont en partie attribuées aux sirops et autres médecines : les doses d’opium n’étaient pas contrôlées et les enfants meurent d’empoisonnement. Pour les médecins qui mènent ces enquêtes, il n’est pas question de supprimer ces produits utiles mais il faut en contrôler l’utilisation, et pour ce faire, en imposer la vente en pharmacie. Il faut également éduquer médecins et pharmaciens qui doivent connaître les dangers des produits. Il faut enfin améliorer les conditions de vie et de travail à l’origine des abus de consommation. En 1868, le Pharmacy Act réglemente l’accès aux produits dont le dosage doit être étiqueté et contrôlé. Le médicament moderne est inventé, l’opium en fait partie. Avec cette première politique de santé publique l’épidémie d’opium est surmontée en quelque cinquante ans.
Au contraire des pays européens, les États-Unis ont privilégié d’entrée une approche judiciaire. Ces différences de stratégies renvoient à des places très différentes occupées par les professions médicales. En Europe, les médecins sont à l’origine des contrôles, qu’ils imposent au corps professionnel dans une alliance étroite avec l’État. Ces contrôles sanitaires contribuent à l’invention de nouveaux modes d’intervention à l’origine de l’État-providence. Aux États-Unis, la surveillance des drogues se fait contre le monde médical, peu formé et mal contrôlé, dans une mobilisation directe des populations. Les pays européens veulent contrôler le produit, les Américains dénoncent les consommateurs. Une nouvelle stratégie d’intervention s’élabore avec ces trois outils, un cadre législatif, une mobilisation des populations et un contrôle des consommateurs. Ce modèle va s’imposer au monde entier, au détriment de l’approche médicale qui perd, au tournant du XI Xe siècle, son rôle hégémonique.
En Europe, le contrôle des drogues fait appel à la technicité professionnelle. Aux États-Unis, la mobilisation invoque la morale. Trois forces vont dénoncer les méfaits des drogues : les mouvements de tempérance, le syndicalisme ouvrier et la presse pour grand public. Les mouvements de tempérance allient puritanisme et réformisme social. Des associations féministes, telle la Woman’s Christian Temperance, mènent le combat au nom de la protection de la femme et de l’enfant. Tous dénoncent les vices d’une société du « laisser-faire » et entendent protéger l’homme contre lui-même. Le principal danger est bien sûr l’alcool mais sont également dénoncées toutes les substances où l’homme risque de perdre le contrôle de lui-même.
Le combat des syndicats ouvriers est bien différent. Leur objectif est de protéger les ouvriers blancs de la concurrence étrangère. La lutte contre l’opium, c’est d’abord la lutte contre les immigrants chinois, main d’œuvre bon marché appelée en renfort pour la construction du chemin de fer. Le péril jaune est dénoncé : c’est la civilisation tout entière qui est menacée de dégénérescence. La presse à sensation est appelée en renfort. Elle vient de naître. Elle s’empare du sujet et dénonce à l’envi scandales et turpitudes. Dans les arrière- boutiques des blanchisseries chinoises, des jeunes sont séquestrés, des femmes violentées. Illustré de faits divers, un imaginaire social va associer durablement drogues, crimes et races. À l’opium des Jaunes succède la cocaïne des Noirs ou la marijuana des Chicanos, avec les mêmes procédés. Une véritable démonologie s’invente : l’avenir de l’humanité est menacé, seul un sursaut moral peut éviter la dégénérescence inéluctable.
Sous la pression de groupes tels que le parti de la Prohibition, créé en 1869, des lois de prohibition sont promulguées dans différents États. Mais cette étrange croisade sera menée sur le plan international avant de parvenir à s’imposer au niveau fédéral. Première étape de ce combat mondial, l’annexion de l’archipel des Philippines. L’opium y est en vente libre. Un rapport officiel rédigé à la demande de Roosevelt dénonce les trafics internationaux : la protection des peuples américains passe par l’interdiction internationale de l’opium. Tandis que les Américains tentent, après les Britanniques, de pénétrer les territoires chinois, le révérend Charles Brent suggère d’aider les Chinois dans leur bataille contre l’opium. Impératif moral et intérêts économiques pourraient ainsi être heureusement conjugués. Le président Roosevelt se range à son avis et préfère, à l’organisation coûteuse d’une expédition militaire, l’organisation d’une conférence internationale. Après de difficiles négociations, la première Conférence internationale est organisée à Shanghai en 1909, suivie de la Conférence de La Haye en 1912. L’évêque Brent et le docteur Wright, qui en sont les promoteurs, ont ainsi construit le fondement juridique et idéologique de la plupart des formes de contrôles existant à l ‘heure actuelle dans le monde.
Les effets des conventions internationales n’ont pas été immédiats. Au-delà des déclarations de principe, l’unanimité des treize signataires n’est qu’apparente. Chaque pays s’est engagé à supprimer graduellement l’opium de ses territoires, mais cette suppression impliquait une reconversion du commerce international et des productions industrielles. Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, ni la Grande-Bretagne ni la France ne songent à éradiquer l’opium de leurs colonies. La régie de l’opium en Indochine récoltera ses bénéfices jusqu’en 1945. Quant à l’Allemagne, elle n’a aucunement l’intention de sacrifier les bénéfices de ses industries chimiques. Mais ces deux conventions ont bien instauré un nouvel ordre international. La convention de la Haye engageait ses signataires à élaborer des législations nationales qui visent à éradiquer l’opium et les autres drogues dangereuses. Et de fait, les pays signataires vont s’engager les uns après les autres dans l’élaboration de ces législations nationales. Les États-Unis montrent l’exemple. En 1914, le Dr Wright tire argument de la convention internationale pour obtenir la première loi fédérale de prohibition, l’Harrisson Act. En France, la loi est votée en 1916, en pleine guerre mondiale. Une campagne de presse contre la cocaïne, « l’arme des Boches », convainc la Chambre des députés. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, ces mesures sont demandées et préparées par des médecins. Mais la loi marque un tournant dans les pratiques comme dans les représentations : du statut de malade, le toxicomane est passé au statut de délinquant.
La drogue ressuscitée
Des années 30 aux années 50, l’objectif d’éradication des drogues pouvait sembler réaliste. En France, les premières épidémies de drogues, la morphine des années 1880-1890, l’opium de la Belle Époque, la cocaïne des années 20 avaient bel et bien sombré dans l’oubli. L’usage de drogue semblait bien étroitement limité à quelques coloniaux, professions médicales et artistes. Mais brutalement, les pays occidentaux sont confrontés à une nouvelle vague de consommation de drogue. Ou plus précisément à une série d’épidémies qui semblent se succéder sans relâche. Dès les années 50 apparaît aux États-Unis une nouvelle génération de jeunes toxicomanes. Ils appartiennent d’abord à des minorités ethniques, noires ou hispaniques, mais au milieu des années 60, les jeunes Blancs à leur tour adoptent dans le même mouvement les drogues et les musiques de ces communautés opprimées. Entre 1965 et 1967 en Californie, les jeunes sont pris de vertige et ce vertige gagne de proche en proche toute la jeunesse occidentale (7). En Grande-Bretagne, en Hollande, en Allemagne, le mouvement contestataire associe également « drogues, sexe et rock and roll ». L’Europe du Sud semble un temps protégée, traditions vinicoles et luttes politiques se conjuguant pour faire face aux drogues de la contestation, mais la fin des espoirs révolutionnaires en France et en Italie, la mort de Franco en Espagne ouvrent la voie à la revendication d’un « Tout, tout de suite », associée, comme Outre-Atlantique, à des consommations de drogues, cannabis et LSD. La contestation des années 60 a accompagné un bouleversement culturel qui a profondément modifié nos relations aux autres et à nous- même. Comme souvent au cours de l ‘histoire, les drogues ont servi d’instrument de passage, elles ont accompagné le changement. Le mouvement de révolte des jeunes a bien engendré « un nouvel état de conscience » que réclamaient ces marginaux volontaires.
La consommation des drogues toutefois n’a pas disparu avec le mouvement de contestation des années 60. L’utopie communautaire des hippies a fait place à l’individualisme des années 80 mais l’engouement pour les drogues semble bien s’être enraciné au cœur des sociétés occidentales. Avec la crise économique du milieu des années 70, l’héroïne d’abord, puis la cocaïne prennent le relais. Les significations des consommations se sont profondément modifiées, mais les consommations de drogues illicites perdurent. À chacune des étapes, elles semblent se démocratiser davantage. La consommation d’héroïne, limitée en France à quelques cercles de marginaux pendant les années 70, a gagné les quartiers populaires au début des années 80 et accompagné le processus de marginalisation de ces quartiers, tandis que la cocaïne et autres drogues stimulantes répondent à l’exigence d’une performance sans cesse accrue (8). À la fin des années 80, la consommation de drogues semblait enfin s’être stabilisée mais les années 90 voient surgir de nouveaux consommateurs : la grande épidémie des années 60 et 70 avait touché une partie très minoritaire de la jeunesse, les consommateurs d’ecstasy et de cannabis semblent aujourd’hui bien plus nombreux. Nous sommes encore au cœur de la galaxie des années 60 et loin de nous déprendre des vertiges chimiques..
À chacune des étapes de la diffusion des drogues illicites a répondu un renforcement des dispositifs répressifs. La logique de l’escalade est internationale. Au tout début des années 70, l’inquiétude est générale et presque tous les pays se dotent des moyens législatifs d’une lutte qui était restée symbolique ou très marginale jusque dans les années 60. Dans la plupart des pays occidentaux, le renforcement des peines est accompagné d’une offre de soin pour les toxicomanes, porte de sortie de jeunes qui sont aussi les enfants des classes moyennes, mais les budgets indiquent clairement les priorités. En 1972 aux États-Unis, le président Nixon engage la guerre, les budgets de la répression s’envolent et 500 000 usagers de cannabis sont incarcérés. Tous les hommes d’État ne sont pas également convaincus de l’efficacité de la guerre. En 1976, le président Carter tente de calmer le jeu, convaincu que la répression n’est pas une réponse adéquate à l’usage. Mais la logique guerrière progresse d’elle-même : la répression stimule le trafic sans diminuer pour autant la demande, la violence s’accroît, l’inquiétude de l’opinion aussi. Pour rassurer l’opinion, de nouvelles mesures sont prises. La machine s’est emballée.
La France est prise dans le même mouvement. La loi de 1970 a aggravé les peines pour trafic, qui sont passées de quatre années d’incarcération dans la loi de 1916 à dix années. En outre, elle a introduit un nouveau délit : l’usage privé de drogues. L’injonction thérapeutique devait contrebalancer cette aggravation des peines mais, de fait, cette solution de rechange à l’incarcération a été peu utilisée. En 1976, dans un rapport officiel, madame Monique Pelletier recommande de ne pas incarcérer les usagers simples (9). Une circulaire est élaborée en 1978 dans cet objectif, elle ne sera pas appliquée. Pendant toutes les années 80, le nombre de toxicomanes incarcérés ne cesse de croître, tandis que progresse parallèlement le nombre des consommateurs.
Pour une réponse de santé publique
La loi de 1970 est inscrite au Code de santé publique mais les auteurs de la loi sont bien loin de considérer la drogue comme un problème de santé. Clairement, la loi de 1970 rappelle la norme à laquelle l’individu doit se conformer. La transgression de la norme menace l’ordre social, la sanction pénale rappelle au drogué qu’il vit en société avant de l’empêcher de s’auto-détruire. La toxicomanie n’est pas un problème de santé publique, affirmait le rapport de Monique Pelletier en 1976, ou du moins, nuançait-elle, il ne l’est pas encore : « Cela pourrait le devenir s’il y avait 1 00 000 « grands toxicos » ou 500 morts par « overdose » par an. » La position sera tenue tout au long des années 80 et réaffirmée dans le rapport Trautman en 1989 (10).
La représentation collective de la toxicomanie comme transgression de la loi nous a conduits à minimiser, voire à dénier purement et simplement les problèmes de santé auxquels les usagers de drogue sont confrontés (11). Effet de sidération ou refus du catastrophisme, la situation alarmante des toxicomanes face au sida n’a guère suscité de réactions en France. Pendant toutes les années 80, le silence a été général : silence de la presse, silence des pouvoirs publics, silence des spécialistes. Pour ces derniers, il importait d’abord de ne pas céder à la panique et de refuser la dramatisation qui justifie traditionnellement les mesures les plus répressives. À la montée des inquiétudes, les professionnels du soin répondaient épidémiologie : que sont 80 000 toxicomanes et 200 morts par overdose, au regard des 4 millions d’alcooliques et des 40 000 morts d’alcoolisme ? La toxicomanie n’étant pas considérée comme une maladie, y compris pour les soignants eux-mêmes, mais comme une transgression, les spécialistes redoutaient avant tout la « médicalisation »des toxicomanes.
Nos voisins européens ont réagi tout autrement.
Dans une tradition de santé publique, la Grande-Bretagne, dès que le risque de contamination par le virus du sida pour les toxicomanes a été identifié, a recherché les réponses les plus efficaces face à l’ épidémie. Pourquoi, s’interrogent les épidémiologues britanniques, certaines villes ou régions sont-elles plus touchées que d’autres ? À Édimbourg où les pharmaciens refusaient de vendre des seringues aux toxicomanes, les taux de séroprévalence du sida des usagers de drogues étaient évalués de 45 à 55 % alors qu’ils étaient de 5 à 10 % dans la ville voisine de Glasgow où les seringues étaient vendues en pharmacie. Les seringues devaient donc être le plus accessibles possible. Autre constat de terrain, à Liverpool où les traitements de substitution étaient largement accessibles (soit près de 4 000 toxicomanes en traitement à la méthadone), le taux de séroprévalence était resté très bas, soit moins de 1 % alors que la moyenne nationale était d’environ 10 %. Les traitements de substitution devaient donc être largement développés. Au-delà des seringues et des traitements de substitution, la prévention ne peut être efficace si elle n’associe pas les personnes concernées. Les usagers de drogues doivent donc être des relais de prévention auprès de leurs pairs. L’ensemble de ces mesures forme les bases d’une politique de santé publique dont l’objectif est de protéger la santé des usagers de drogues, sans nécessairement attendre qu’ils aient abandonné l’usage de drogues. Le raisonnement est le suivant : qu’on le veuille ou non, des personnes utilisent des drogues. On évalue généralement à 5 à 10 % par an le nombre de toxicomanes qui se désintoxiquent. Les 90 % restant doivent pouvoir protéger leur santé, en attendant qu’ils acceptent ou puissent se désintoxiquer. Cette politique a été baptisée « Harm reduction », soit réduction des risques liés à l’usage de drogues. Sous la menace du sida, les spécialistes britanniques préconisent de donner la priorité à cette politique de santé au détriment de la politique répressive, priorité qu’ils parviennent à imposer au gouvernement de madame Thatcher.
En France le tournant est pris entre 1992 et 1994. Avant cette date, une seule mesure avait été prise, la vente libre des seringues en 1987. Avec quelque dix ans de retard, nous commençons, très lentement, à sortir d’une problématique où la drogue n’était envisagée que du point de vue de l’opinion publique, où il importait de rassurer et non seulement de prendre en considération la santé mais aussi la marginalité et l’exclusion. Il aura fallu trois années de débat pour que la gravité de la situation tant sanitaire que sociale soit reconnue. Le diagnostic est posé dans le rapport de la Commission Henrion : la France est confrontée à une épidémie de sida des plus graves, les toxicomanes encombrent les prisons, l’insécurité liée à la drogue n’est pas qu’un sentiment, la mortalité est sévère, l’état de santé, précaire, et le dispositif de lutte fait de nous le pays le plus répressif d’Europe. Et le rapporteur conclut : « La politique de lutte contre la toxicomanie, fondée sur l’idée selon laquelle il ne faut rien faire pour faciliter la vie des toxicomanes, a provoqué des catastrophes sanitaires et sociales (12). »
La politique de réduction des risques est devenue en juin 1994 la politique officielle du ministère de la Santé (conférence de presse de madame Simone Veil). Sont préconisées toutes les mesures qui favorisent l’accès aux seringues, tels les programmes d’échanges de seringues, tandis que s’ouvrent les premiers services accueillant des toxicomanes actifs, avec café, sandwichs, machines à laver, soins infirmiers et matériel de prévention. Ces accueils font émerger toute une population en situation d’urgence qui était précédemment exclue des soins et de la prévention. Autre axe de cette politique : les traitements de substitution. Deux produits acquièrent le statut de médicament, la méthadone en avril 1995 et le subutex en janvier 1996. En un an à peine, près de 30 000 toxicomanes entrent en traitement. Les résultats sont immédiats. À Paris, où l’offre de soin est la plus importante, le nombre d’overdoses est réduit de 50 % en deux ans, de 149 en 1994 à 102 en 1995 et moins de 70 en 1996.
Il aura fallu un véritable mouvement social pour que ces mesures soient acceptées. Ce mouvement se constitue au cours de l’année 1992. Il réunit les différents acteurs qui, isolément au cours des années 80, avaient été amenés à développer de nouvelles pratiques. Parmi eux, des acteurs issus de la lutte contre le sida, des médecins généralistes qui expérimentent à tâtons les premiers traitements de substitution, des militants de l’action humanitaire qui, les premiers, inaugurent un programme d’échange de seringues, des professionnels de terrain, engagés, aux marges des institutions de soins, dans des actions locales ou des actions de santé communautaires, et enfin des personnes directement concernées, malades du sida, proches et usagers de drogues, qui commencent à se regrouper dans des associations.
Favoriser l’association d’usagers de drogues, distribuer des seringues, prescrire des traitements de substitution impliquent d’accepter l’usage de drogues et de renoncer à l’objectif prioritaire d’éradication des drogues. À l’exception des Pays-Bas, ces changements ont été adoptés sous la menace du sida, mais ces nouvelles stratégies se sont imposées d’autant mieux que le bilan des années de guerre à la drogue n’a rien de glorieux. Car la guerre à la drogue n’est pas qu’un mot d’ordre. Des armées sont engagées, des hommes en meurent, et cependant l’objectif d’éradication des drogues qui justifie cette guerre apparaît chaque jour plus illusoire. La menace du sida a rendu nécessaire un « aggiornamento » mais, plus globalement, les pays européens s’engagent un à un, non sans hésitations et sans débats, dans la recherche d’une politique alternative, à la fois moins meurtrière et plus efficace.
Les toxicomanes doivent-ils avoir « le droit de se droguer » ? Doit-on renoncer à la prohibition des drogues ? Il est bien évident que le mouvement de réduction des risques n’aurait eu aucun écho si, parallèlement, le système prohibitionniste n’était sérieusement ébranlé. Les politiques de réduction des risques ne sont pas pour autant le «cache-sexe» de prohibitionnistes qui s’avanceraient « masqués », pour reprendre un terme utilisé dans le débat aux États-Unis. Il y a bien un changement de perspective mais ce changement tient à la modestie de ses objectifs. Les politiques de réduction des risques ne prétendent pas résoudre le problème de la drogue et de la toxicomanie, elles ne préjugent pas de l’évolution ultérieure, que nul ne peut prévoir, elles se contentent de résoudre les problèmes qui peuvent l’être, en revenant aux objectifs initiaux des politiques de lutte contre la toxicomanie, à savoir la protection des personnes. En abandonnant l’illusion d’un monde sans drogues, peut-être apprendrons-nous à domestiquer le dragon.
Notes
1. L. Lewin, Phantastica, drogues psychédéliques, Payot, 1970.
2. A. Escohotado, Histoire élémentaire des drogues, Éditions du Lézard, 1995.
3. P. Butel, L’opium, histoire d’une fascination, Perrin, 1995.
4. P. Furst, La chair des dieux, l’usage rituel des psychédéliques, Le Seuil, 1974.
5. C. Bachmann, A. Coppel, Le dragon domestique, Albin Michel, 1989, rééd. La drogue dans le monde, Le Seuil, coll. Point, 1991.
6. T. de Quincey, Les confessions d’un mangeur d’opium, Gallimard, « L’Imaginaire », 1990.
7. J.-P. Bouywou, P. Delannoy, L’aventure hippie, Éditions du Lézard, 1995.
8. A. Ehrenberg, L’individu incertain, Calmann-Lévy, 1995.
9. M. Pelletier, Rapport de la Mission d’étude sur l’ensemble des problèmes de la drogue, La Documentation française, 1978.
10. C. Trautman, Lutte contre la toxicomanie et le trafic des stupéfiants, La Documentation française, 1990.
11. A. Coppel, « Toxicomanie, sida et réduction des risques », in Vivre avec les drogues, Communications, Le Seuil, janvier 1996.
12. Rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, La Documentation française, 1995.