- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
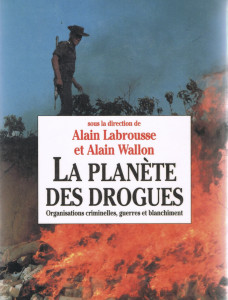 S’il existe quelques indicateurs – si discutables soient-ils – du marché de la drogue en termes macro-économiques, la micro-économie de la drogue reste, en grande part, une terre inconnue. C’est que la recherche dans ce secteur cumule toutes les difficultés : outre le caractère illégal de l’objet, qui rend nécessaire la construction d’indicateurs spécifiques, son étude implique la maîtrise de logiques très diversifiées, à la fois économiques et culturelles, des usages de drogue aux ressources qu’offrent les réseaux de sociabilité, et ce, dans un système de contrainte qui doit intégrer aussi bien le cadre législatif – plus précisément les pratiques policières – que les logiques de marché telles que la concurrence des réseaux d’approvisionnement. Alors que ce secteur de recherche est sans légitimité institutionnelle, il exige un investissement qui ne peut s’envisager sans volonté politique. De fait, les recherches existantes sont directement ou indirectement liées aux dispositifs d’intervention, répression, soins ou prévention. En France, des recherches ont lieu dans le cadre de politiques publiques, développement social des quartiers ou prévention de la délinquance : quel est le poids du trafic et de la consommation de drogue sur les sociabilités quotidiennes, les relations inter- ethniques, les trajectoires de marginalisation des jeunes ?
S’il existe quelques indicateurs – si discutables soient-ils – du marché de la drogue en termes macro-économiques, la micro-économie de la drogue reste, en grande part, une terre inconnue. C’est que la recherche dans ce secteur cumule toutes les difficultés : outre le caractère illégal de l’objet, qui rend nécessaire la construction d’indicateurs spécifiques, son étude implique la maîtrise de logiques très diversifiées, à la fois économiques et culturelles, des usages de drogue aux ressources qu’offrent les réseaux de sociabilité, et ce, dans un système de contrainte qui doit intégrer aussi bien le cadre législatif – plus précisément les pratiques policières – que les logiques de marché telles que la concurrence des réseaux d’approvisionnement. Alors que ce secteur de recherche est sans légitimité institutionnelle, il exige un investissement qui ne peut s’envisager sans volonté politique. De fait, les recherches existantes sont directement ou indirectement liées aux dispositifs d’intervention, répression, soins ou prévention. En France, des recherches ont lieu dans le cadre de politiques publiques, développement social des quartiers ou prévention de la délinquance : quel est le poids du trafic et de la consommation de drogue sur les sociabilités quotidiennes, les relations inter- ethniques, les trajectoires de marginalisation des jeunes ?
Autre série de questions tout aussi déterminantes : quel est l’impact des interventions répressives, comment, à quel prix, avec quels effets participent-elles du contrôle des drogues ? Ces questions ont par exemple été étudiées dans une comparaison entre Rotterdam et le Bronx. La qualité du produit apparaît ainsi comme l’un des déterminants du comportement des toxicomanes. Ainsi, à Rotterdam, la plupart des héroïnomanes renoncent aujourd’hui à l’injection ; dans la mesure où le produit est de bonne qualité, ils peuvent obtenir les effets qu’ils recherchent en le fumant (selon la technique dite de « la chasse au dragon »). Dans un contexte plus répressif, comme dans le Bronx, le toxicomane est plus directement dépendant du trafiquant et se voit imposer des produits coupés qu’il s’injecte pour mieux en ressentir les effets.
La question de l’impact des traitements de substitution sur le marché de la drogue a été posée à plusieurs reprises, et tout d’abord à la fin des années 1960 en Grande-Bretagne, sous l’angle suivant : dans quelle mesure les produits prescrits participent-ils du marché noir ? Mais il existe aussi quelques travaux ethnographiques qui visent à rendre compte de l’impact sur un site d’une offre de soins systématique. Pour la région de Mersey par exemple, la recherche s’est inspirée du travail effectué par R Hugues dans un quartier de Chicago, dans une zone de trafic et d’usages de drogues (copping area) à la fin des années 1970. Ce travail est tout à fait exemplaire tant en termes d’intervention que de recherche. Dans le cadre d’une mobilisation communautaire, des soins sont systématiquement proposés aux toxicomanes, méthadone ou désintoxication ; l’intervention est associée à une recherche ethnographique sur la structure micro-locale de l’offre de drogue, les conclusions de ce travail étant que l’offre de soins et la mobilisation locale sont parvenues à un contrôle effectif de l’offre de drogue pendant tout le temps de l’action (soit deux années : 1976-1978).
Les paradigmes de la demande
Comme tous les acteurs économiques, les usagers de drogue effectuent des« choix raisonnés », soit une analyse coût/avantages dont la rationalité ne peut être comprise si on ne tient pas compte des contraintes auxquelles ils sont confrontés. À quoi, par exemple, est due l’extrême variabilité des prix, de 1 à 10 suivant les villes européennes ? Alors que l’acteur économique est censé choisir le meilleur produit au meilleur prix, d’autres variables interviennent ici : l’usager peut privilégier un produit plus cher mais pour lequel les risques sont – ou lui paraissent – moindres. Il peut également privilégier un produit immédiatement accessible face à un produit moins coûteux, voire de meilleure qualité, mais qui exige une prévision et une organisation antagoniques avec son mode de vie. Que ce type de choix puisse être interprété en termes de psycho-pathologie, et plus précisément ici de pharmaco-dépendance, n’invalide pas pour autant le raisonnement : quelles que soient les causes – toute conduite humaine se prête à interprétation -, l’acteur n’en effectue pas moins un choix. Car il y a bien choix à terme. L’acteur peut renoncer à l’usage lorsqu’il estime, dans une économie qui lui est personnelle, les bénéfices inférieurs aux coûts. En témoignent les quelques travaux sur les sorties de la drogue et sur le contrôle de l’usage, mais aussi le fonctionnement du marché : celui qui ne contrôle plus sa consommation finit par être exclu des réseaux de revente. Ces réseaux de revente sont un capital relationnel, qui repose sur la crédibilité, testée au quotidien par les fournisseurs, mais aussi par les clients.
Logiques économiques et logiques sociales sont ici intrinsèquement liées. L’acte économique, achat ou revente, doit s’interpréter au regard de la signification de l’usage. Pratique sociale, la drogue (usage et trafic) s’inscrit dans un système relationnel qui en donne la signification. Aux Etats-Unis, le système relationnel décrit par les ethnologues est celui du monde de la drogue envisagé comme subculture, mais on peut aussi concevoir les échanges liés à la drogue comme participant d’un système d’échange plus général. C’est le choix que font P. Bouhnik et M. Joubert (Economie des pratiques toxicomaniaques et lien social, Passage, 4, 3, 1992) lorsqu’ils décrivent le marché de la drogue comme relevant des systèmes d’échanges et d’entraide des cités, systèmes qui fonctionnent comme des « apprentissages de cité ». L’extrême diversité des organisations locales du marché de la drogue en Europe est ainsi liée aux systèmes de sociabilité dans lesquels l’usage de drogue mais aussi son commerce s’insèrent, comme en dépend aussi l’organisation de toute entreprise délinquante.
Réseaux de distribution et formes d’organisation
Différents modèles d’organisation coexistent ou plutôt se concurrencent, qui articulent ressources sociales et logiques économiques. Dom et South construisent ainsi une typologie des entreprises de distribution de la drogue qui peuvent être regroupées en deux classes, selon qu’elles sont spécifiques ou qu’elles intègrent le trafic de drogue à d’autres activités :
1) non spécifiques à la drogue :
- – Entreprise commerciale légale, élargissant ses activités à la drogue,
- – Entreprise criminelle étendant ses activités à la drogue,
- – Système «informel opportuniste », soit des petits groupe engagés dans l’économie informelle, y compris la drogue.
2) spécialisées dans le drogue :
- – Spécialistes de la revente (employés par un patron spécialisé),
- – Société mutuelle (réseaux amicaux revente-usage),
- – Communautés commerciales (trading charities) engagées dans le trafic de drogue pour des raisons idéologiques,
- – Distributeurs soutenus par l’Etat (buy-bust).Une étude effectuée par Frase et George (1988) sur les réseaux de distribution confronte l’ensemble des données disponibles dans une ville (Seadown, ville imaginaire dans le Sussex) et décrit le passage d’une distribution de type liste à des spécialistes de la distribution. Soit un réseau de 101 membres, avec la hiérarchisation suivante :
- – grossistes à grande échelle (plus de 1 kilo) = 7 personnes,
- – grossistes à petite échelle : 1 à 2 onces = 7 personnes,
- – détaillants : effectuant des transactions avec usagers (au gramme, soit 10livres maximum): 25 personnes,
- – usagers finaux : 62 personnes.Le réseau est relativement fluide ; le nombre important de grossistes est lié au fait qu’ils ne peuvent intervenir que ponctuellement. Les usagers finaux ne représentent qu’une partie de la clientèle. Autour de ce réseau, des usagers occasionnels ou récréationnels représentent environ 150 à 300 personnes (ce qui renvoie au problème de la définition du toxicomane/population cachée).
Cité de banlieue et développement de nouvelles formes d’organisation
Nous assistons aujourd’hui en France, ou du moins en banlieue parisienne, au passage d’un trafic relativement mobile, fluide et qui relève d’une logique « mutualiste » à un trafic qui se professionnalise peu à peu, avec une différenciation des rôles. Dans la mesure où les études sont très peu nombreuses, l’historique de la structuration du trafic en banlieue parisienne est difficile à reconstruire et on ne dispose que de quelques indicateurs ou plus précisément d’indices qui permettent de formuler ces hypothèses. Le système économique du début des années 1980 a été décrit par Ingold : il s’agissait du trafic de rue à Paris, trafic qui se déroulait dans ce que les Anglo-Saxons nomme « scène », c’est-à-dire des lieux emblématiques de la drogue : Belleville, Barbès, le Forum des Halles, l’îlot Chalon, où les usagers d’Ile- de-France venaient s’approvisionner. La répression a amené les petits trafiquants, ceux qui étaient directement en contact avec les usagers, à se décentraliser. Différents quartiers de la banlieue parisienne ont ainsi accueilli les petits et moyens grossistes, avec pour effet le développement d’une clientèle locale et l’explosion de la consommation du début des années 1980 en banlieue.
La drogue est progressivement devenue partie intégrante de l’économie souterraine et des sociabilités de certains quartiers. Cette intégration a été inégale selon les quartiers et renvoie à des modalités d’organisation du trafic différentes. Dans la majorité des lieux, le phénomène est contenu, c’est-à-dire qu’il est peu visible ; le trafic reste fluctuant et les formes d’organisation correspondantes sont majoritairement mutualistes. Quelques quartiers de la banlieue sont en passe de devenir les supermarchés locaux : pour des raisons qu’il reste à étudier, le marché de la drogue a peu à peu occupé tout l’espace public.
Je pense à une cité dont le spectacle est impressionnant. Au contraire de la Goutte-d’Or ou du Forum des Halles, où j’ai effectué mes premières enquêtes, cette cité ressemble, pour l’étranger qui la traverse, à une ville déserte. Excepté à l’heure de la sortie de l’école, pas un seul habitant, pas une vieille dame avec chien … C’est que le quartier est sous » haute surveillance : les enfants, dont c’est le premier travail, en sont les guetteurs. Mais leur rôle ne s’arrête pas là. Comme dans les ghettos américains, ils peuvent également être chargés du transport des drogues. La cité est passée sous le contrôle du trafic, dirigé, selon la formulation qui est adoptée dans les rumeurs, par quelques familles qui régissent le quartier en fonction des nécessités du trafic.
« Braquage » et usage de drogues dans les escaliers sont également interdits. Dans ce quartier pas de problème qui risque de justifier l’intervention de forces extérieures, qu’il s’agisse de la police ou de la santé.
Cette organisation souterraine est récente ; elle peut être datée, dans la mesure où elle est directement liée à l’intervention des forces de police. A la fin des années 1980, le trafic se faisait ouvertement, jour et nuit, et les habitants se plaignaient de sa visibilité. Quelques interventions policières ont modifié les formes d’organisation. Le réseau s’est doté d’une organisation qui lui permet de rester invisible et de « tenir » le quartier. Il s’est aussi armé. Aujourd’hui, les rapports sociaux tels qu’ils sont rapportés, entre jeunes mais aussi entre jeunes et adultes, se règlent chaque jour davantage sur les logiques de trafic. Ceux qui n’y participent pas sont contraints de ne rien voir et restent soigneusement enfermés chez eux.
Les méthodologies classiques de recherche ne parviennent pas à saisir ce phénomène clandestin : les trafiquants doivent pouvoir se protéger tant des toxicomanes, peu fiables face aux services de police, que des habitants. Or le silence est obtenu.
On peut supposer que ces organisations utilisent les outils habituels des organisations mafieuses, à savoir la peur et la complicité. Les cités organisées exclusivement autour du trafic de drogue sont aujourd’hui l’exception. Il est évident que le trafic se développe là où il rencontre le moins de résistances, dans les quartiers refermés sur eux-mêmes, sans services, commerces et vie sociale publique. Il est clair aussi que des interventions policières ponctuelles peuvent contribuer au renforcement de ces organisations souterraines, en particulier dans les contextes d’exclusion et de marginalité.
Sans doute serait-il temps de prendre la menace au sérieux : sentiment d’insécurité et sentiment d’exclusion ne peuvent se traiter par des actions purement symboliques lorsque les réseaux illégaux s’organisent et tendent à maîtriser l’ensemble des échanges sociaux, et lorsqu’il n’existe, en terme d’insertion, que peu d’alternatives à la marginalité et à la délinquance. Nous continuons de crier au loup alors qu’il s’est déjà transformé en dragon.