- Auteur.e.s :
- Éric Favereau
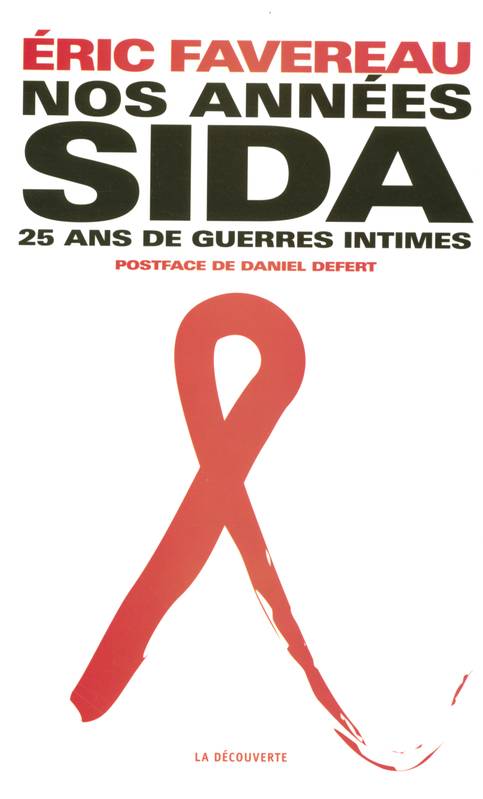
Entretien Éric Favereau / Anne Coppel
Question / Éric Favereau : Dans votre histoire, vous évoquez toujours une date clé…
Anne Coppel : Il y a eu un moment clé pour moi. Et sans l’ombre d’un doute, c’est le congrès mondial sur le sida qui s’est tenu à Amsterdam, en juin 1992 qui a marqué une rupture. Ce fut une véritable révélation.
Éric Favereau : Pourquoi 1992 et Amsterdam ? L’épidémie de sida chez les toxicomanes était déjà vieille de plus 5 ans. La toxicomanie, le sida, c’était un domaine que vous connaissiez bien avant…
Anne Coppel : C’est vrai. En 1990, le Dr Touzeau et moi avions ouvert un petit programme méthadone au Centre Pierre Nicole sous la direction du Dr Aimé Charles-Nicolas. Une expérience assez brève, car le Dr Touzeau et moi avons été mis à la porte, suite à des conflits institutionnels. Comme lot de consolation, l’administration de la Santé nous a proposé d’ouvrir un programme dans le 92 en le négociant avec les cinq centres de soins de ce département. Pourquoi pas? Il nous fallait convaincre les collègues de ce département, tous hostiles à la méthadone. C’était presque mission impossible ; moi-même à l’époque, si j’étais pour la méthadone, je ne parvenais pas à lui donner le statut de « médicament » ; j’avais du mal avec la notion de traitement. C’est dans le cadre de ce débat que je me suis mise à lire toute la littérature internationale sur le sujet. J’ai découvert qu’il y avait dans les pays anglo-saxons un débat nourri de nombreuses études et expérimentations, un débat dont les Français ignoraient tout. A l’origine de ce débat, une première étude qui montrait qu’à New York, dès 1985, 60% des héroïnomanes de rue avaient renoncé à partager leurs seringues, en s’informant les uns les autres. Ainsi pouvait-on faire appel à la responsabilité des personnes selon le principe sur lequel repose la lutte contre le sida. Faire appel à la responsabilité du toxicomane ? Voilà qui était inimaginable en France. Je me suis mise fébrilement à sauter d’un article à l’autre. J’étais toute excitée par ce que je découvrais.
Éric Favereau : Comment étiez vous perçue, à cette époque ?
Anne Coppel : Je n’en ai aucune idée. A l’exception de l’équipe de Charles-Nicolas avec laquelle je travaillais, je n’étais pas connue. Je n’étais pas médecin, je venais du monde de la recherche en politique sociale.
Éric Favereau : Et arrive donc le congrès mondial du sida d’Amsterdam…
Anne Coppel : Oui. Et donc, j’y arrive dans un état d’esprit très particulier: trouver des informations, mais aussi la confirmation de ce que j’avais lu. Nous étions quelques Français dont le docteur Bertrand Lebeau de Médecins du Monde qui était dans la même démarche. Il était alors journaliste médical et il s’était engagé à faire une enquête sur la prévention du sida auprès des usagers de drogues. Je l’ai accompagné dans son enquête. C’était impressionnant, tous ceux que nous interrogions nous renvoyaient notre question : “ Mais qu’est que vous faites, vous les Français” ? Et cette question finissait par nous renvoyer à nous-mêmes : qu’est-ce que nous faisions nous-mêmes ? En même temps, ce que l’on entendait n’était pas simple à déchiffrer, en tout cas pour quelqu’un comme moi.
Éric Favereau : Pourquoi ?
Anne Coppel : Je n’avais jamais considéré la question des drogues sous l’angle de la santé publique. Les Anglais étaient, pour moi, des gens qui faisaient du toxicomane un malade chronique. Cela allait à l’inverse de mes croyances. Et voilà qu’à Amsterdam ces Anglais nous posaient des questions très précises, loin des débats idéologiques : « Mais qu’est-ce que vous faites ? Vous devez faire face à l’épidémie la plus grave en Europe. Quelles mesures avez-vous prises ? » On leur répondait que depuis 1987, les seringues avaient été mises en vente libre. « Mais est-ce que les usagers peuvent réellement avoir accès aux seringues ? », nous demandaient-ils. Ou encore : « Et comment faites-vous pour soigner à l’hôpital ceux qui consomment de l’héroïne, si les médecins refusent toute prescription ? » Indiscutablement, ces usagers étaient exclus des soins. Bref, nous avons pris conscience d’un décalage massif entre la France et les autres participants.
Éric Favereau : Pourquoi cette question a eu une telle résonance chez vous ? Car vous faisiez des choses, vous étiez, tout sauf passive.
Anne Coppel : Je faisais des choses. Je faisais de la réduction de risques sans le savoir. Mais c’était microscopique. Avec Didier Touzeau, nous avions bien ouvert un programme méthadone mais qu’est ce que cela changeait à la situation, si ce n’est, bien sûr, pour nos 12 patients ? D’ailleurs, ce premier programme a été ouvert à la condition d’être tenu secret, une condition que nous avons respectée. Je me suis rendue compte que j’avais vécu dans un double langage. C’était bien joli de penser à voix basse qu’il fallait réagir. Mais à qui l’avais-je dit ? De fait, j’avais respecté le tabou qui interdisait tout débat public, ce qui soulevait une nouvelle question : qui devait mener ce débat et investir la parole publique?
Éric Favereau : Et la réponse ?
Anne Coppel : Il n’y avait pas de réponse si ce n’est « les personnes concernées ». Et j’en faisais partie. Il a d’abord fallu que je comprenne ce que signifiait « santé publique », qu’elle n’était pas l’imposition d’une norme sociale, qu’elle faisait appel à la responsabilité des personnes concernées. Comme je le disais tout à l’heure, j’avais toujours bloqué sur le fait que la toxicomanie n’était pas une maladie. Je considérais que si l’usage de drogue posait problème, c’était pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la santé publique. J’entendais ce mot uniquement sous la lunette du contrôle social.
Éric Favereau : C’est à dire ?
Anne Coppel : Prenons les programmes méthadone. Longtemps, j’ai cru que leur objectif était uniquement de “contrôler” les usagers. Pourquoi donner un produit qui ne donne pas de plaisir mais qui rend dépendant, si ce n’est pour faire venir les toxicomanes au quotidien et contrôler, analyse d’urine à l’appui, qu’ils ne prennent plus de drogues ? Mais je savais aussi que la méthadone pouvait être utile, qu’elle pouvait être utilisée par les héroïnomane pour maîtriser leur consommation, pour «se stabiliser », selon la formule. C’était cela ma motivation pour ouvrir un programme, et non pas les problèmes de santé, du moins au niveau conscient. C’est à Amsterdam que j’ai découvert que face à la toxicomanie, une réponse de santé publique, -c’est à dire une réponse qui fasse appel aux usagers pour prendre en charge leur santé -, paraissait possible. Et surtout, donnait des résultats.
Éric Favereau : Auparavant, les problèmes de santé des toxicomanes étaient pour vous secondaires…
Anne Coppel : Je n’y avais pas vraiment réfléchi. Aussi longtemps que les usagers étaient en bonne santé, nous n’en parlions pas…
Éric Favereau : Pourtant, vous connaissiez des gens qui mourraient.
Anne Coppel : Oui. C’est à peine incroyable. Ils mouraient, je le savais, et ils mouraient du sida. Je n’ignorais rien. J’ai lutté comme j’ai pu contre cette maladie. J’ai accompagné des gens qui allaient mourir, mon copain en est mort. Et j’ai appris moi-même que j’étais séropositive en 1988. Bref, le sida, non seulement ne m’était pas étranger, il avait bouleversé ma vie, à tous les niveaux. Et pourtant, je ne parvenais pas à mettre des mots sur ce que nous vivions.
Éric Favereau : Quand vous avez appris votre statut sérologique, les questions de santé ne vous sont pas venus à l’esprit, comment dire, naturellement ?
Anne Coppel : Non. Quand j’ai appris que j’étais séropositive, j’ai pensé à deux choses, d’abord que j’allais mourir bientôt. Je devais donc utiliser au mieux les années qui me restaient, et ne faire que ce qui m’intéressait vraiment. Le 2ème constat, c’est qu’au niveau des relations sexuelles, cela devenait très compliqué : là, le déni n’était pas possible. Le reste…..
Éric Favereau : Mais alors comment expliquer ce déclic sur la santé publique ? Est-ce qu’il s’agissait d’accepter le passage d’une analyse individuelle à une analyse collective ?
Anne Coppel : Sans doute ; et si nous avons eu tant de mal à passer à une analyse collective, c’est qu’il nous fallait tout remettre en cause, nos croyances, les logiques institutionnelles, les pratiques, les relations avec les usagers. Accepter qu’il y ait une approche de santé par rapport aux problèmes de toxicomanie, c’était accepter que les médecins aient une place là dedans. Aujourd’hui, cela paraît évident mais à l’époque, il y avait un consensus pour résister à ce que nous appelions « la médicalisation des toxicomanes ». Ainsi, il n’y avait pas de médecins généralistes dans les centres de soins, seulement des psychiatres. Ce changement de cadre s’est fait par étape. Il m’a d’abord fallu partir d’une évidence – à savoir que le sida était une maladie qui exigeait des réponses de santé publique. La deuxième étape pour moi a été de reconnaître que lorsque l’on traite la toxicomanie comme une maladie, cela donne de meilleurs résultats que si on la traite uniquement comme un problème psychologique.
Éric Favereau : En d’autres termes, regarder la toxicomanie par la lunette médicale n’avait pas que des mauvais cotés.
Anne Coppel : Effectivement, même si je pensais que c’était réducteur. Il fallait bien constater qu’en prenant ce cadre, les usagers mouraient moins, et il ne s’agit pas seulement de santé somatique, ils étaient aussi mieux dans leur peau. Si j’ai vécu ce changement sur le mode d’une révélation, c’est que brusquement, ce que je vivais sans avoir des mots pour le dire devenait évident. Avant cette fameuse conférence, je ne m’étais jamais dit que les usagers de drogues étaient en danger de mort. Voilà qui, avec le sida, relevait de l’évidence mais cette évidence là était comme invisible. On a du mal aujourd’hui à imaginer le changement conceptuel que cela imposait. Pour la plupart des intervenants, ce changement de cadre a été encore plus difficile que pour moi parce qu’ils ne savaient pas ce que vivaient les usagers hors du système de soin, et puis parce qu’ils diabolisaient les produits : la méthadone, c’était une drogue, donc c’était mal. C’était là ce qui m’exaspérait mais je partageais la même indifférence – ou plus exactement le même déni de l’état de santé réel, le même refus du traitement médical.
Éric Favereau : C’était bien une croyance collective. À l’époque, tout le milieu des intervenants en toxicomanie se refusait à “soigner” les conséquences de la toxicomanie.
Anne Coppel : Nous vivions dans un système schizophrène. Que pouvait donc signifier « soigner » si, comme le pensait presque tous les spécialistes, il n’y avait pas de maladie? Les contradictions entre la loi – qui définit la toxicomanie comme maladie – et les croyances des soignants étaient passées sous silence. Silence sur les injonctions thérapeutiques que les médecins signaient à la chaîne, parce qu’ils savaient que les usagers n’étaient pas des malades. Silence sur la question du sevrage qui était l’objectif assigné au soin par la loi mais qui n’était pas celui des soignants, puisque pour eux, le véritable problème n’était pas la consommation de drogues mais la souffrance psychique. Les meilleurs spécialistes savaient comme moi que les cures de sevrage ne marchaient pas mais personne ne disait que les cures de désintoxication aboutissaient à 90% de rechute. C’était comme un secret de famille. Il aurait fallu remettre en cause la loi de 1970 or tout le système de soin reposait sur un pacte, un pacte qui avait été scellé par Olievenstein autour de la loi de 1970
Éric Favereau : C’est à dire ?
Anne Coppel : Un drôle de pacte. On peut en formuler les termes ainsi : les médecins acceptent de ne pas remettre en question la loi à la condition qu’ils ne soient pas contraints de soigner ce qui pour eux n’était pas une maladie. A l’époque, les experts dont Dr Olievenstein, considéraient l’usage de drogue comme une révolte, une forme que pouvait prendre la crise de l’adolescence. Avec la loi de 1970, la société voulait exiger que les jeunes se conforment à la norme mais cet impératif ne devait être confondu avec un traitement médical. Aussi ont-ils obtenu que l’injonction thérapeutique soit volontaire et anonyme. De cette façon, la justice ne pouvait contrôler ce que fait le médecin. Tout le monde y gagnait, pensait-on à l’époque, la loi était apparemment respectée, les soignants n’étaient obligés de soigner et enfin cette loi préservait la liberté de choix du toxicomane, il n’était pas obligé de soigner. Personne ne se souciait des termes réels de ce choix, à savoir soit une cure qui menait à 90% d’échec soit la rue. Que se passait-il pour ceux qui continuaient de se shooter – c’est à dire la grande majorité ? La dépendance était pensée en termes purement psychologiques, pour ne pas dire moraux.
Éric Favereau : Mais tous ces décès ne forçaient pas à réagir ?
Anne Coppel : Dans la culture professionnelle ambiante, parler de la mort était perçu comme de la dramatisation. Et dramatiser, c’était faire le lit de Le Pen. Alors, nul ne considérait comme bien venu un discours sur les toxicomanes-morts-du-sida.
Éric Favereau : Et dans la pratique ?
Anne Coppel : Dans la pratique quotidienne, on dédramatise aussi, car on ne peut pas vivre dans le drame permanent. C’est aussi ce que font les usagers, la mort est vécue un risque accepté, on ne s’y attarde pas. C’est triste, mais c’est comme le risque chez un motard. On pleurait. Mais bon. La souffrance ne se partageait pas.
Éric Favereau : Les premiers morts, vous les mettiez sur le compte de la drogue ou du sida ?
Anne Coppel : On ne parlait pas de morts. Et puis dans le milieu du soin, ces morts étaient souvent invisibles. Les gens passaient, disparaissaient, mais qu’est ce qu’il leur arrivait ?…. Nous ne cherchions pas à le savoir, c’était comme si le courage se mesurait au silence. Sur le sida, le premier souvenir que j’ai remonte à Berlin, en 1985. Avec Didier Touzeau. A l’occasion d’un débat, j’ai entendu cette nouvelle étrange : la moitié des toxicomanes, dans une prison en Allemagne, étaient contaminés. Je me souviens du sentiment de terreur que j’ai ressenti. Cela voulait dire que la moitié de ceux que je connaissais, pour certains mes amis, allaient mourir. On essayait de se rassurer les uns les autres. « Il ne fallait pas parler de sida, disait-on, mais de séropositivité ». Il y avait, certes, un mal terrible mais il ne fallait pas l’évoquer. Chacun se débrouillait comme il pouvait avec cette menace et je n’imaginais pas d’autres réponses qu’individuelles, en allant plus loin dans l’accompagnement, avec des relations plus chaleureuses mais nous avions à cœur de ne rien laisser paraître. C’était cela, la réponse digne. Autrement, cela s’appelait flipper. Et flipper, on évite.
Éric Favereau : En quelle année, votre ami est-il mort ?
Anne Coppel : Ce n’est pas très facile pour moi d’en parler… C’est un garçon, avec qui j’ai eu une histoire d’amour, passionnelle en 1969. Il a ressurgi dans ma vie en 1987, parce qu’il était malade du sida et qu’il voulait me revoir, avant de mourir. J’ai vécu un an avec lui, j’ai été contaminée très certainement par lui, il est mort peu de temps après. Pendant un an, nous étions repartis dans une relation passionnelle, comme si rien ne s’était passé entre temps mais je ne savais plus où j’en étais. En 1969, ni lui ni moi ne consommions des drogues. Quand nous nous sommes retrouvés, il m’a dit qu’il avait été toxico pendant 20 ans alors que moi, je commençais à travailler dans ce champ
Éric Favereau : Dans les années 80, vous aviez arrêté toute drogue.
Anne Coppel : Absolument. J’avais vécu quelque chose de fort avec les drogues au début des années 70 mais c’était devenu un plaisir purement répétitif qui ne m’apportait plus rien. En fait, j’étais devenue une sorte de toxico du travail.
Éric Favereau : En 1989, vous allez à AIDES.
Anne Coppel : Cette année là, j’avais travaillé sur la question des femme et du sida, ainsi qu’avec des femmes prostituées. Je pensais que l’entraide était une des premières réponses à développer, comme nous l’avons fait avec le BUS des Femmes. Aussi j’ai trouvé tout naturel d’aller à AIDES pour moi-même. Mais je n’ai pas réussi à parler de mon histoire, de mon itinéraire de femme et d’usagère. J’étais contaminée par voie sexuelle mais j’étais aussi très marquée par l’expérience que j’avais eue des drogues et en plus je travaillais au quotidien avec des usagers.
Éric Favereau : Que représentait AIDES pour vous ?
Anne Coppel : En 1988, j’avais entendu Daniel Defert, lors d’un débat. Daniel parlait de AIDES, comme d’une association de solidarité entre les malades. Cela m’a frappée et touchée. AIDES a donné un sens collectif à ce que je faisais à un niveau purement individuel. Daniel a parlé aussi des seringues, ajoutant que le pont avec « les toxico-thérapeuthes » était difficile à établir. Je comprenais pourquoi et il m’a donné envie d’aider à faire ce pont, ce qui était aussi aider les toxico à sortir de leur ghetto. Mais en même temps, à AIDES, je n’ai pas réussi à parler de ce que je vivais. Les gays qui consomment des drogues – et ils sont assez nombreux – n’en parlent pas. Le résultat, c’est que dire « je » lorsqu’on parle des drogues vous donne obligatoirement une étiquette de « toxicomane » – une identité dans laquelle je ne me reconnaissais pas, ni au présent ni même au passé.
Éric Favereau : Comment avez vous commencé à vous occuper des programmes méthadone ?
Anne Coppel : En 1989, j’ai eu un choix à faire. Si je voulais être titularisée à l’Université de Paris 13 où j’étais chargée de cours j’aurais du passer une thèse. A cette époque, je pensais qu’il me restait peu d’années à vivre, et lorsque Didier Touzeau m’a proposé de travailler avec lui, je n’ai pas hésité longtemps. Je me suis dit que j’avais la chance de vivre ces années-là avec un travail en relation avec ce que je vivais personnellement. Je savais que la méthadone pouvait être utile, à certains du moins. C’était une réponse logique à une situation autrement inextricable. A cette époque, les centres de soin mais aussi les services hospitaliers renvoyaient à la rue les usagers qui étaient pris en train de consommer des drogues. C’était la règle. On disait que ce n’était pas grave, que c’était juste la galère habituelle, celle qu’ils avaient choisi de vivre. Quelle sauvagerie ! Didier Touzeau et Charles- Nicolas ont décidé de faire ce projet méthadone après la mort d’une jeune femme enceinte qui n’avait pas pu arrêter de consommer des drogues. Et puis, il y avait dans ce choix une part de provocation mais j’étais loin d’imaginer la violence de l’hostilité de la plupart des spécialistes….
Éric Favereau : Et à l’époque, vous restiez réservée sur la méthadone.
Anne Coppel : Oui ou plutôt j’étais réservée sur la façon dont fonctionnaient les programmes méthadone mais je savais que les usagers utilisaient des produits de substitution, tels que la codéine, en vente libre et je savais que c’était utile. Cette vente libre de la codéine est d’ailleurs un exemple du double langage de l’époque. Les spécialistes comme le Dr Olievenstein la considéraient comme une porte de secours, ce qui leur permettait de ne pas « se salir les mains » en prescrivant eux-mêmes. Ainsi l’usage de codéine ou de tout autre substitut restait de la cuisine entre drogués, une cuisine qui ne concernait pas les médecins. J’ai longtemps pensé que c’était suffisant.
Éric Favereau : À partir de 1986-1987, arrivent les premiers médicaments contre le virus du sida. Cela ne devait-il pas redonner une justification à une démarche de soins aux malades du sida, non ?
Anne Coppel : Oui et non. L’AZT ? Au départ, j’étais réticente, en tout cas pour moi-même. Je préférais ne pas me considérer comme une malade. Profiter au mieux du sursit qui m’était accordé, tant que ma santé me le permettait. Bien sûr, si tu as un abcès, tu prends un antibiotique, c’est à dire un médicament qui marche. Mais se lancer dans une machinerie thérapeutique où tu abîmes les trois dernières années de ta vie, non, je ne voulais pas cela.
Éric Favereau : Et le préservatif ?
Anne Coppel : Oui, bien sûr. Et j’étais bien placée pour en connaître les difficultés… C’est une des raisons pour lesquelles je pensais qu’il nous fallait faire un travail collectif, en parler, y réfléchir, se soutenir… .
Éric Favereau : Et comble de l’ironie, vous qui étiez réticente pour ne pas dire ouvertement opposée au monde médical, aujourd’hui vous voilà la championne de la “santé publique”.
Anne Coppel : Oui, il y a eu un vrai switch dans ma tête. J’en parle comme d’une révélation parce que brusquement, l’évidence s’imposait, une évidence en cohérence avec ce que je vivais sans mots pour le dire et qui rendait incompréhensibles les contradictions où je me débattais avant.
Éric Favereau : Et ce changement, ce “schwitch” a été collectif ?
Anne Coppel : Oui, c’est un travail qui s’est fait d’abord avec les quelques Français qui ont participé à ce congrès, dans une confrontation internationale. Je crois que pour s’affronter à des croyances collectives, le raisonnement logique ne suffit pas. Il faut vivre quelque chose de fort et il faut pouvoir partager avec d’autres cette expérience vécue. C’est la raison pour laquelle il a été si difficile de convaincre au-delà de ce noyau dur initial. Il a fallu que des médecins commencent à prescrire et qu’ils partagent cette expérience avec leurs collègues pour qu’ils acceptent l’idée qu’il s’agissait bien là d’un traitement. Maintenant, c’est devenu une évidence pour eux. Encore a-t-il fallu qu’ils acceptent de commencer à prescrire…
Éric Favereau : Est-ce que vous auriez pu faire ce switch plus tôt ?
Anne Coppel : Je me demande souvent, si j’avais été au premier colloque sur la réduction de risques, qui s’est tenu, à Liverpool, en 1990, est-ce que j’aurais fait ce schwtich à cette époque? Et si je l’avais fait, aurais-je pu entraîner les gens? Je n’en sais rien. Ce qui est sûr, c’est qu’à Amsterdam nous avons été plusieurs à enfin comprendre l’urgence de sortir de l’ambiguïté et du double langage. Mais en 1992, c’était déjà si tard.
Éric Favereau : Aujourd’hui, vous vous soignez correctement…
Anne Coppel : Je me soigne, j’ai accepté la trithérapie. Prendre un traitement, c’est se rappeler chaque jour qu’on est malade, c’est toujours aussi difficile pour moi. Mais cet été, j’allais mal et je n’avais plus vraiment le choix. Mais pas plus aujourd’hui qu’hier, je ne veux pas sacrifier le présent au futur.