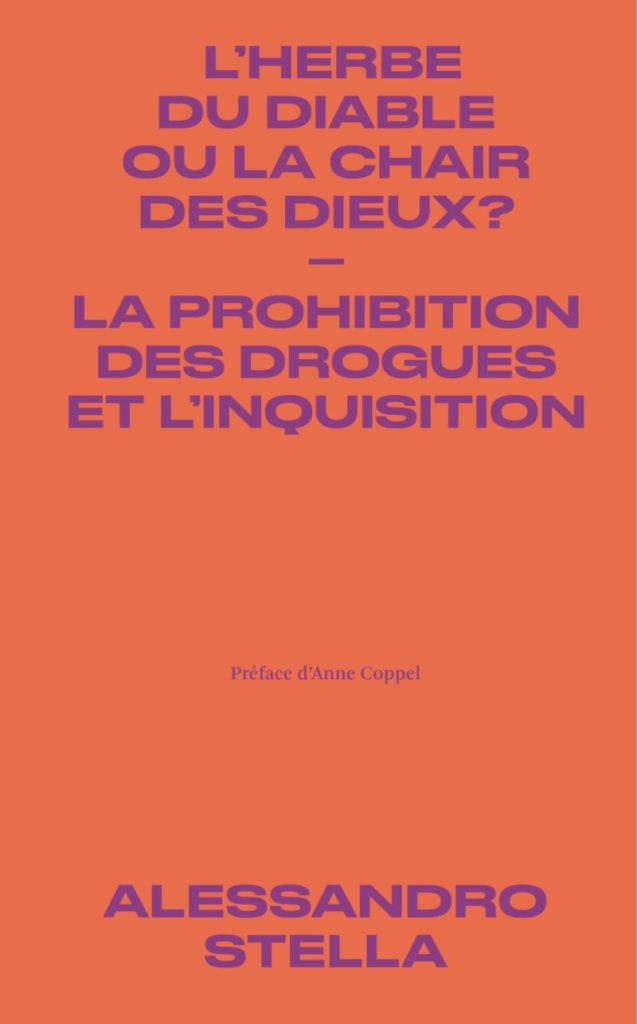- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
- Alessandro Stella
Préface
Pourquoi la prohibition des drogues ? Quel diable a donc saisi l’humanité ou, du moins, ceux qui la gouvernent, pour prétendre éradiquer des plantes psychotropes avec lesquelles nous coexistons depuis des millénaires – et c’est à minima, pour se limiter aux traces connues de ces consommations. Car, comme le rappelle Alessandro Stella, « sur le temps long de l’histoire, la prohibition des drogues est un phénomène tout-à-fait récent », à peine plus d’un siècle. Aussi, en étudiant l’Edit du 19 juin 1620, la première mesure de prohibition du peyotl au Mexique, sa recherche apporte un éclairage saisissant sur l’origine de cette politique internationale. Une enquête passionnante : comme dans les séries policières sur les affaires classées, elle donne vie à tous les acteurs de cette scène du crime. Avec les comptes rendus des procès, surgissent les personnages clés de cette terrible machinerie, et d’abord les Inquisiteurs, sans oublier la concurrence des autres autorités religieuses. L’enquête rend compte des débats théologiques et juridiques qui ont justifié la mesure et qui ont orienté sa mise en œuvre, car l’affaire est d’importance, on ne fait pas n’importe quoi au nom de Dieu. L’instruction judiciaire est menée selon des règles bien précises, elle peut durer des années, il y a même des manuels pour traiter des questions litigieuses, comme par exemple : Y a-t-il eu ou non pacte avec le démon ? Y –a-t-il apostasie, hérésie ou sorcellerie ? Au-delà du religieux, et avec l’instruction judiciaire, les inculpés, hommes et femmes, bien souvent issus de métissages variés, font apparaître les nouvelles appartenances sociales engendrées par la colonisation.
À tout seigneur, tout honneur : on commence donc d’abord par prendre connaissance des personnages qui ont été à la manoeuvre, à savoir les Inquisiteurs. Les uns avaient déjà acquis une longue expérience de la guerre contre les superstitions, comme le premier évêque de Mexico, le frère Juan de Zumarraga, formé à la traque des idolâtres et hérétiques en son pays basque natal et qui a instruit 1883 procès pour idolâtrie entre 1536 et 1543, bien avant l’Edit prohibant la consommation du peyotl. D’autres sont des évangélisateurs, comme le père Jacinto de la Serna, qui a consacré sa vie à décrire « le panthéon des divinités amérindiennes pour mieux en dénoncer la nature hérétique et démoniaque de leur culte ». Contraint néanmoins de prendre acte de son échec, car les croyances et les pratiques idolâtres persistaient, la conversion des Indiens ayant eu comme principal effet d’ajouter le Christ aux divinités existantes, les Saints eux-mêmes pouvant donner lieu à des invocations suspectes. Ces évangélisateurs se vivent comme de « Grands protecteurs des Indiens », un titre que se donne par exemple le premier évêque de Mexico à la pointe du combat évangélique.
Comme on le voit, il n’y a pas que Big Bother de 1984 pour inventer une « nove langue » marquée par l’inversion du sens, où la paix est invoquée pour mener la guerre, où « la pacification » masque trop souvent des carnages. « La protection des Indiens » fait partie de ces euphémismes qui, selon Georges Orwell, servent à défendre l’indéfendable. C’est là une constante des régimes dictatoriaux qui tous ont recours à ces stratégies linguistiques dont la fonction est de justifier les outils de contrôle des peuples dominés.
Car c’est bien de ce dont il s’agit. Les évangélisateurs sont en première ligne de la conquête des âmes, une conquête qui se mène d’abord et essentiellement, comme le rappelle Alessandro Stella, les armes à la main. On ne s’étonnera pas que la prohibition ait d’abord été une affaire religieuse, en particulier dans le monde anglo-saxon, comme le montre l’histoire des premiers traités internationaux, au début du XXème siècle. Mais au cours des années 1960, une nouvelle génération d’usagers de drogue le découvre d’expérience. Aux Etats-Unis comme en Grande-Bretagne, les jeunes hippies et contestataires s’affrontaient aux valeurs puritaines transmises par leurs parents. Rapidement, ils n’ont pas eu de doute : les drogues ne sont pas interdites parce qu’elles sont dangereuses, comme le prétendent les autorités officielles, elles sont interdites parce qu’elles donnent du plaisir.
La prohibition des drogues est ainsi enracinée dans une morale puritaine qui prône la renonciation des plaisirs de la chair, mais au-delà du poids de la religion, cette recherche met en lumière le lien étroit que la prohibition entretient avec la colonisation. Au Mexique, comme plus largement en Amérique latine, la conquista se mène dans un contexte particulier, marqué par l’interdiction de l’esclavage massif des Indiens par Charles Quint en 1542. Après la controverse de Valladolid, qui oppose entre eux les théologiens, les Indiens ont acquis une âme, autrement dit le statut d’êtres humains, ce qui impliquait qu’ils devaient être évangélisés. Désormais, il ne s’agit pas seulement de piller les richesses du Nouveau Monde et de conquérir de fructueux marchés, il faut également soumettre les esprits. Or qu’il s’agisse des corps ou des esprits, l’entreprise de domination se pose en ces termes : comment contrôler les millions d’Indiens avec quelques milliers de conquistadors et quelques centaines de missionnaires ? Chaque colonisateur a sa stratégie propre. Ainsi, les autorités de l’Empire Britannique se gardent bien de remettre en cause les pouvoirs traditionnels, en mesure de soumettre l’ensemble de la population. C’est aussi ce que font en partie les autorités de l’administration coloniale du Mexique, mais les évangélisateurs se donnent une mission autrement plus ambitieuse : la soumission des esprits à l’ordre colonial, un ordre qui repose sur la reconnaissance du monopole de la vraie foi, la religion catholique. La lutte contre les superstitions, les pratiques divinatoires, ou encore les blasphèmes, les déviances sexuelles, la bigamie ou la sodomie est une lutte mondiale, car en Europe même les pratiques divinatoires et magiques, héritées des païens, persistent également, – et ce jusqu’à aujourd’hui – mais le monothéisme était devenu la croyance dominante au cours des siècles précédents. Convaincre les Indiens que les visions qu’offre ce petit cactus, le peyotl, honoré depuis quelques 3000 ans, sont l’œuvre du diable est une autre paire de manche !
Le premier obstacle est lié à la fréquence de sa consommation, ainsi d’ailleurs que d’autres plantes hallucinogènes, champignons, racines ou lianes, consommations qui à la lecture des procès paraissent relativement banalisée. Nombre des accusés reconnaissent en avoir consommé, en toute innocence, affirment-ils, dans l’ignorance de l’interdit. Une voisine, un serviteur leur a proposé un breuvage, alors qu’ils étaient en difficulté : des bœufs avaient disparu, des objets avaient été volés, une femme voulait savoir si son mari était toujours vivant, une autre voulait séduire l’être aimé… À ces pratiques divinatoires, il faut ajouter les pratiques thérapeutiques. Elles ne sont pas mentionnées dans le premier Edit de prohibition parce que le recours aux herbes médicinales est une pratique habituelle et le restera jusqu’à la fin du XIXème siècle. C’est aussi que le corps médical colonial n’est pas encore en mesure d’imposer son monopole sur le soin. Aussi ce qui est passible de sanction, ce n’est pas le recours aux plantes qui soignent, ce sont les cérémonies qui célèbrent leur caractère sacré.
Il faudra attendre l’invention du médicament dont la composition est connue et contrôlée pour que le pouvoir médical soit en mesure de prendre la relève du pouvoir religieux. En Angleterre, ce nouveau monopole s’annonce avec Pharmacy Act en 1868. Cette réglementation peut être considérée comme l’acte de naissance de la santé publique et il se trouve que la mesure est prise pour contrôler les potions à base d’opium, largement utilisées alors pour calmer les bébés, et qui faute d’un contrôle des doses avait provoqué une surmortalité révélée par les premières enquêtes sur la condition ouvrière. En France comme en Grande-Bretagne, les premières mesures de santé publique ont pour objectif le contrôle du produit, médicament ou poison selon la dose, et non pas le contrôle du consommateur. Cette logique va prévaloir dans la santé publique au contraire de la prohibition telle que nous la connaissons aujourd’hui. Contrôle des produits ou contrôle des consommateurs, il s’agit là d’un enjeu majeur en termes de politique des drogues. Le pouvoir religieux veut contrôler le consommateur, il exige l’abstinence, mais au début du 20ème siècle, les États signataires se sont contentés d’un objectif de contrôle du marché de l’opium et autres substances illicites si bien que les Etats coloniaux comme la France ont poursuivi le commerce de l’opium jusqu’à la deuxième guerre mondiale. La bascule de la prohibition internationale des drogues vers un objectif exclusif d’abstinence se fait par étape. Dans les années d’après-guerre, la prohibition internationale invoque la santé publique, mais avec « la guerre à la drogue », slogan du président Nixon adopté par l’ONU en 1971, la politique internationale des drogues a renoué avec l’objectif religieux d’abstinence. La guerre à la drogue s’est révélée être une guerre aux drogués, un contrôle du consommateur qui prend ses racines dans la religion. Au XVIIe siècle ce contrôle participait alors d’une « mise en règle spirituelle des terres conquises ».
Les rites barbares, la musique, la danse, les chants qui accompagnent la consommation du peyotl et autres plantes ne sont pas sanctionnés seulement dans une logique de concurrence des mondes magiques, polythéisme contre monothéisme, ils sont considérés comme « l’antichambre de la luxure ». Les Inquisiteurs condamnent tous les plaisirs de la chair et plus particulièrement la sexualité considérée comme désordonnée, accusation récurrente en particulier pour les femmes, ce que souligne Alessandro Stella. Elles sont soupçonnées soit de provoquer l’impuissance sexuelle des hommes, soit d’inciter à la débauche. La pauvre Catalina Varela, désignée comme coyota, doit répondre à cette double accusation par son mari qui la croit à l’origine de « l’inflammation de ses parties » et qui, selon sa belle-sœur, amènerait « dans sa grotte de jeunes garçons » avec lesquels elle se livrait à des danses érotiques. « La marque d’origine de la honte, le péché sexuel, était transférée par le système inquisitorial sur la mulata », écrit Alessandro Stella. Ces femmes sont souvent des « filles du péché », conçues hors mariage, telle Barola de Zamora, doublement illégitime, puisqu’elle est fille d’un curé et de son esclave. On ne sait pas trop comment les tribus indiennes qui n’ont pas renoncé à la consommation du peyotl se sont protégées de l’intrusion de l’Inquisition et des autres autorités catholiques, mais incidemment on apprend que les Indiens n’aimaient pas prendre du peyotl avec ceux qui croyaient y voir l’œuvre du démon … Voilà qui ne surprendra pas les consommateurs modernes, qui eux aussi ont appris d’expérience que le contexte de la consommation détermine en grande partie les effets de ces plantes magiques, qu’il faut donc les consommer entre soi, avec « les bonnes personnes, au bon moment, dans un bon lieu », pour citer Norman Zinberg, qui a étudié l’usage contrôlé des drogues et qui à ce titre est considéré comme un précurseur de la réduction des risques liés à l’usage[1].
Le deuxième obstacle à la répression de la consommation est lié aux circulations mondiales des hommes et des produits qu’ils consomment, circulations engendrées par la colonisation. Les épices et les drogues psychotropes faisaient déjà l’objet de commerce depuis la Haute antiquité, mais les échanges vont d’abord au rythme lent des caravanes ou des migrations et ils se limitent à quelques produits. Avec la colonisation, les échanges s’accélèrent, les marins transportent d’un continent à l’autre les produits qu’ils consomment avec les façons de consommer qu’ils ont eux-mêmes adoptés. C’est le cas en particulier de l’opium que les marins portugais avaient mélangé avec le tabac découvert en Amérique du Sud, et qu’ils fumaient pour le plaisir, au contraire de l’usage traditionnel en Chine ou en Inde, où l’opium était le plus souvent ingéré en petite quantité dans une fonction thérapeutique. Cet opium fumé deviendra objet de commerce que l’Empire britannique a imposé à la Chine les armes à la main, avec le soutien des autres puissances coloniales, dont la France. L’opium s’introduira ultérieurement au Mexique, mais dès le 16ème siècle, une plante aux effets psychédéliques a attiré l’attention d’Alessandro Stella, « l’herbe de la bergère », appelée d’abord au Mexique la Rosa-Maria. « Un faisceau d’indices concordants » écrit-il, indiquent que la rosa maria est sans doute l’ancêtre de la marijuana. La plante est interdite le 7 février 1691, s’ajoutant aux interdits précédents qui, outre le peyotl, portent sur l’ololiuqui ou pipiltlizintli, ce qui n’a pas empêché que les curanderos l’adoptent et l’intègrent à leurs rituels. On observe ainsi un métissage des pratiques magiques, associées à un syncrétisme religieux. On ne sait pas jusqu’à quel point les différentes tribus indiennes ont réussi à résister aux croyances chrétiennes, au dualisme qui oppose par exemple le corps et l’esprit, mais les ethnologues et voyageurs du 19ème siècle, puis du XXème, décrivent encore des rites qui attestent de la présence de l’esprit des morts parmi les vivants.
Les Inquisiteurs sont d’ailleurs très conscients des obstacles auxquels ils s’affrontent. Aussi, dès le premier Edit, la bienveillance est recommandée, et lorsque la faute est avouée, les repentants peuvent être graciés. Il me semble que le profil très particulier des accusés témoigne directement ou indirectement d’un même pragmatisme qui prend acte de l’impossibilité de sanctionner systématiquement les millions d’Indiens. Nombreux en effet sont les inculpés d’origine métissée, et qui se retrouvent ainsi aux marges des communautés existantes. Ainsi Nicolas Candelario de Vargas, arrêté et interrogé par le commissaire du Saint-Office, a commencé son interrogatoire « en déclinant sa généalogie de noirs, mulâtres et quelque mélange d’indien », affirmant qu’il était « baptisé, confirmé et en règle avec les préceptes de la communion et de la confession ». Ces nouveaux déviants sont classés comme Mestizos, Mulâtreset Noirs, classement de base qui pouvait ensuite se décliner en Coyotes, c’est à dire métis de mestizo et d’indienne, et autres nuances de métissage. Les femmes sont très nombreuses, non seulement parce que comme les sorcières de l’Occident, elles incitent l’homme au péché, mais aussi parce que la conquête du territoire se marque par la conquête du corps des femmes. Ainsi, dans un procès, « trente d’entre elles avaient été dénoncées, parmi lesquelles quatorze étaient indiennes, six espagnoles, trois coyotas, deux mestizas et une mulâtresse ». Pour les quatre femmes restantes, le notaire de l’Inquisition indiquait que deux étaient réputées indiennes (« tenida por india ») et quant aux deux autres il doutait qu’elles aient été indiennes (« duda el notario si son indias »). Aussi, les femmes mulâtresses âgées de 45-50 ans sont des cibles privilégiées des Inquisiteurs, en particulier lorsqu’elles se retrouvent libres et maîtresses d’elles-mêmes.
Tous ces métis engendrés par la colonisation sont des sortes de mutants pour les sociétés traditionnelles. Entre deux ou trois mondes, ils ébranlent de par leur naissance les répartitions sociales et genrées des rôles sociaux. Ils sont en situation de « passeur culturel », relève Alessandro Stella, une situation précieuse si l‘on admet que ce Nouveau Monde implique l’élaboration d’un langage commun et plus généralement la construction de nouvelles relations sociales. Le métissage atteste de « la perméabilité des communautés », avec des processus d’acculturation qui sont immédiatement à l’œuvre dès qu’une culture est confrontée à une autre. Mais en découvrant qui étaient les inculpés de cette époque, ou plus précisément quelles étaient leurs origines, je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux accusés actuels, ceux et celles qui payent le prix fort de la politique des drogues, en commençant par la France. J’ai toujours su qu’il valait mieux être blanc de peau pour échapper aux contrôles policiers mais il nous aura fallu des années pour dénoncer à voix haute le caractère racialisé de la guerre à la drogue. Nous savions tous que les principales victimes de la répression sont ceux qu’on appelle « les jeunes de cités ». Cette euphémisation passe sous silence le fait que les jeunes en question sont le plus souvent des enfants de migrants venus d’Afrique. Il y a ainsi un lien direct entre la lutte contre les drogues et l’histoire coloniale. En nous soumettant au tabou qui passe sous silence les héritages de la colonisation, nous nous sommes interdit de répondre au journaliste réactionnaire Eric Zemmour, qui en 2011 a justifié ainsi les contrôles policiers, qui s’étaient révélés 17 fois plus fréquents pour les non-blancs : « Les Français issus de l’immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes… C’est un fait ». Certes dans les cités de banlieue, où les Noirs et les Arabes sont majoritaires dans la population, mais dans les quartiers chics et bourgeois, de quelle couleur sont les trafiquants ? Mais, eux, ne sont pas pourchassés comme du gibier par les policiers.
« Silence=mort » avait dénoncé ACT-UP dès sa création. L’expérience a montré qu’il faut rompre le silence pour mener une lutte, et c’est le cas si on veut une autre politique des drogues. Il aura fallu la publication de la recherche de la juriste américaine Michelle Alexander, une militante des Droits civiques, pour que la communauté noire américaine prenne conscience qu’elle était la cible privilégiée de la lutte contre les drogues. La politique de tolérance-zéro en a été l’outil, elle s’est accompagnée de campagnes virulentes contre la délinquance, et elle a abouti à quelques 30 millions d’incarcérations entre 1986 et 2006 [2]. Or cette politique de tolérance-zéro, adoptée à partir du milieu des années 1980 aux USA, s’est diffusée un peu partout dans le monde et jusqu’en France où elle a abouti aux peine-plancher en 2007. En France même, la logique de tolérance-zéro s’est appliquée à l’usage de drogue en 2008, en exigeant des sanctions systématiques, avec une application stricte de la loi en cas de récidive, au nom de la lutte contre la délinquance.
Ce que les Français ne savent pas, et que montre Michelle Alexander c’est que les partisans les plus acharnés de cette guerre à la drogue étaient aussi ceux-là qui s’étaient opposé aux Droits civiques, acquis par les noirs américains au cours des années 1960. Cette répression racisée a fait des minorités ethniques la cible privilégiée de la guerre à la drogue, et ce partout dans le monde. C’est d’ailleurs ce qu’ont constaté les experts internationaux de l’ONU lors de la dernière assemblée générale en avril 2016, qui ont appelé à lutter contre les discriminations, dans le respect des droits humains [3].
Ce qui soulève une question : la répression des minorités ethniques ou culturelles dans les pays occidentaux est-elle une constante de la prohibition ? Il faut d’abord constater l’évidence : la prohibition internationale a construit un monopole commercial en autorisant les drogues consommées par les Occidentaux et en interdisant les drogues consommées dans toutes les autres cultures. Ni les militants religieux, à l’origine des premiers traités internationaux, ni les experts médicaux qui leur ont succédé n’avaient conscience de servir un monopole commercial, tous étaient persuadés d’agir au nom de principes universels, invoquant les uns la morale religieuse, les autres le savoir scientifique des médecins, et pourtant les uns et les autres se sont soumis aux exigences d’un dispositif qui a assuré la diffusion mondiale des drogues de l’Occident. Au 17ème siècle, les Inquisiteurs se sont bien gardés d’aller à l’encontre des intérêts du royaume. Ainsi ont-ils renoncé à interdire la feuille de coca, pourtant divinisée comme toutes les plantes psychotropes interdites, mais que les Indiens exigeaient pour accepter de travailler dans les mines. À la fin du XIXème siècle, les médecins hygiénistes en Europe avaient engagé le combat contre l’alcool, considéré comme un des trois principaux fléaux sanitaires, et qu’ils voulaient prohiber. Or la loi de prohibition qu’ils prônaient a bien été votée en 1916, mais l’alcool a échappé aux substances prohibées, à l’exception de l’absinthe. C’est ce que constate en 1924 la garçonne, dans le roman éponyme, qui dénonce l’hypocrisie de la loi votée en 1916, c’est à dire en pleine guerre mondiale : « Ce qu’ils nous embêtent, ces poireaux, au Parlement ! Ils me font rire… Les stupéfiants ! Ce sont eux qui le sont… Et si je veux m’intoxiquer moi ? D’abord, puisqu’ils parlent de poison, qu’ils s’occupent donc de l’alcool ! Mais ça, ils n’oseront pas. C’est le bistrot qui les nomme ».
Aux Etats-Unis, les associations religieuses comme les Quakers qui, avec les féministes se sont engagées dans le combat contre l’alcool, ont bien obtenu sa prohibition en 1920, mais en 1933 le président des États-Unis prend acte de l’échec et met fin à sa prohibition. Dès lors, la prohibition des drogues devient exclusivement la prohibition des drogues de l’Étranger que réclamaient les syndicats ouvriers blancs dès la fin du 19ème siècle. Les campagnes de presse contre l’opium des Chinois, la marijuana des Chicanos et même la cocaïne attribuée aux Noirs sont à l’origine des toutes premières mesures de prohibition prises par quelques états américains à la fin du 19ème siècle.
La logique racialisée l’a emporté. Les experts médicaux nommés par l’ONU après la deuxième guerre mondiale ont été chargés de justifier la liste des substances interdites qui ne répond pas à des critères médicaux communs. Aussi, rien d’étonnant à ce qu’ils ne parviennent pas à donner une définition de « la toxicomanie », ce qu’ils passent sous silence pendant tout le 20ème siècle. Avec l’addictologie aujourd’hui, ils ont été contraints de reconnaître que la liste des interdits n’est pas justifiée par une plus grande dangerosité, mais jusqu’à aujourd’hui ils se sont bien gardés de remettre en cause cette prohibition des drogues consommées dans les autres cultures, la drogue de l’Autre.
C’est précisément ce qui intéresse les premiers chercheurs à expérimenter ces plantes magiques dès la fin du 19ème siècle et surtout dans le siècle suivant. Ils étaient anthropologues, botanistes ou géographes, et comme les voyageurs, les philosophes et les poètes qui leur ont succédé de peu, ils sont partis à la rencontre de l’Autre, des cultures qui échappent à l’emprise de l’Occident, à la recherche de leurs mythes, de leurs croyances, de leurs rituels et des drogues qu’ils consomment. Les plantes magiques ont d’ailleurs à ce titre partiellement échappé à la prohibition. Ces champignons ou cactus voyagent mal, ils n’ont pas été investis par le trafic international, du moins jusqu’à ce jour, ils doivent ou devraient être consommées sur place, si bien que les experts médicaux ont consentis à quelques concessions, quand il a pu être prouvé que les consommations de ces plantes magiques faisaient partie de rituels religieux. Les experts médicaux espéraient ainsi limiter leur diffusion aux cultures ancestrales en voie de disparition.
C’est aussi dans la rencontre de l’Autre que les jeunes des années 1960 expérimentent les drogues interdites. La voie a été ouverte par les poètes et romanciers de la beat generation, et des jeunes de plus en plus nombreux vont à leur tour prendre la route, celle de l’Asie, de l’Inde à la Sibérie, mais aussi celle des amérindiens, des peuples premiers du nord au sud du continent américain. Aux Etats-Unis, ceux que la grande presse désigne comme des hippies vont adopter la marijuana que fument les musiciens noirs qu’ils écoutent, le jazz et le blues qui donne le rythme, la culture du ghetto : « Be what you are » est un des mots d’ordre de ce mouvement contre-culturel, à la recherche de nouvelles subjectivités, en rupture avec les valeurs des WASP, celle des blancs Américains protestants qui ont cru longtemps que leur culture était la civilisation même, et qu’elle avait donc vocation à s’imposer partout dans le monde.
Portée par des ondes musicales dont la circulation est mondiale, les hybridations culturelles vont se multiplier. La consommation des plantes magiques fait partie du voyage, de l’exploration des cultures ancestrales à l’exploration de soi. « Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations, et, au mépris du danger, avancer vers l’inconnu », c’est la mission du vaisseau spatial de l’Entreprise, Star Trek, la fameuse série de science-fiction des années soixante, et cette mission fait écho aux voyages initiatiques qui ne sont plus réservés à une élite, ce qui a aussi eu des effets sur les consommations rituelles. « Tristes tropiques », le livre de Claude Levi-Strauss publié en 1955, annonçait déjà que nul n’échappe à la culture dominante de l’Occident, mais quoi qu’il en soit la consommation des plantes hallucinogènes perdure avec les mêmes fonctions que par le passé : « médical, mystique, hédoniste », comme le rappelle Alessandro Stella. Ces plantes sont loin d’avoir livré tous leurs secrets, explorés aussi bien par l’expérience que par l’approfondissement des recherches. Avec l’enseignement du sorcier Yaki, qui a initié Carlos Castaneda, et à sa suite des milliers de ses lecteurs, les plantes magiques n’ont pas cessé de chanter à notre oreille : « mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ! ».
Anne Coppel
Références :
[1] Norman Zinberg, Drug, set and setting, The basis for controlled intoxicant use, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1984.
[2] Michelle Alexander, La couleur de la justice. Incarcération de masse et nouvelle ségrégation sociale aux Etats-Unis, Paris, Sylepse, 2017.
[3] Anne Coppel, « ONU avril 2016, rupture du consensus sur la guerre à la drogue », Multitudes n°65, Hiver 2016.
Séminaire EHESS 2015-2016
Intervenants :
– Alessandro Stella, « La prohibition du peyotl par l’Inquisition de Mexico »
– Nessim Znaïen (doctorant à l’EHESS), « La prohibition de l’alcool et des drogues en pays d’Islam »
– Discutant : Jean-Pierre Albert (directeur d’études à l’EHESS)
– modérateur : Michel KOKOREFF, sociologue, professeur d’Université, Paris 8