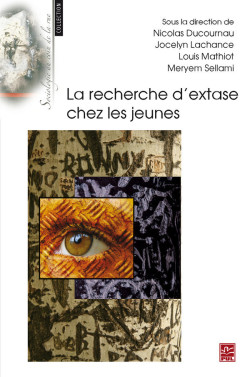- Auteur.e.s :
- Anne Coppel
« La recherche d’extase chez les jeunes »
Ducournau Nicolas, Lachance Jocelyn, Mathiot Louis, Sellami Meryem (dir.),
Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Sociologie au coin de la rue », 2010.
La révolution psychédélique en marche
1964, l’autocar des Merry Prankers, bariolé d’une jungle de mandalas phosphorescents, bardé de hauts-parleurs, d’amplificateurs, de matériel sono flambant neuf s’embarque pour le Grand Voyage, qui d’Ouest en Est traverse l’Amérique pour revenir à son point de départ, la Californie. Deux ans après, le quartier Haight-Ashbury à San Francisco est pris d’une furie collective, des dizaines de milliers de jeunes affluent de tous les États-Unis. Ils sont étudiants ou bien, telle la croisade des enfants du Moyen-Âge, ont quitté leur famille pour vivre « the summer of love ».
 Cinquante mille jeunes en délire, « en grande tenue, à agiter des clochettes, à chanter des hymnes, à danser avec extase, à se défoncer d’une façon ou d’une autre », écrit Tom Wolfe qui, dans « Acid Test », se fait le chroniqueur de l’aventure originelle, celle des Merry Prankers, où s’est expérimentée cette étrange révolution psychédélique (WOLF, 1975). Tout au long du voyage, la joyeuse bande a expérimenté le cocktail magique de l’extase collective. « Sex, drugs and rock and roll », ce slogan provocateur réunit bien les ingrédients nécessaires, mais il en reste aux apparences.
Cinquante mille jeunes en délire, « en grande tenue, à agiter des clochettes, à chanter des hymnes, à danser avec extase, à se défoncer d’une façon ou d’une autre », écrit Tom Wolfe qui, dans « Acid Test », se fait le chroniqueur de l’aventure originelle, celle des Merry Prankers, où s’est expérimentée cette étrange révolution psychédélique (WOLF, 1975). Tout au long du voyage, la joyeuse bande a expérimenté le cocktail magique de l’extase collective. « Sex, drugs and rock and roll », ce slogan provocateur réunit bien les ingrédients nécessaires, mais il en reste aux apparences.
De l’extérieur, les « square », ceux qui sont dans la norme, voient des corps enchevêtrés, une énorme partouze, avec une tribu de chevelus camés jusqu’aux yeux, qui s’agitent sur une musique de sauvage. Les Merry Prankers jouent avec les images, tout au long du voyage, ils se mettent en scène, ils jouent leur propre rôle. L’aventure est un jeu, c’est même le Grand Jeu. Le rire fait voler en éclats l’esprit de sérieux et cette bande de rigolos ne se prend pas au sérieux, même si chacun a le sentiment de vivre une aventure si merveilleuse qu’elle les transforme à tout jamais. Les Merry Prankers ne sont pas des théoriciens, ils pratiquent le déverrouillage de cervelle. Plus que les longs discours, ils aiment les énoncés sibyllins des maîtres zen : « Être synchro », ils n’en disent pas davantage. La musique donne le beat, le rythme. Les drogues psychédéliques ouvrent les portes immémorielles qui nous coupent de notre propre monde. Elles font voir le système de catégories qui font que les gens vivent selon les perceptions de leurs ancêtres. La perception linéaire du temps est un de ces héritages. Le LSD, cette drogue de laboratoire, est une drogue du futur parce qu’elle peut remodeler le passé au présent. Quant au sexe, honni de la morale puritaine, il fait partie de soi et la règle d’or, c’est d’être entièrement soi-même : « Be What You Are ». Synchro avec soi-même, c’est la condition pour être tous ensemble. Ce que les Merry Prankers expérimentent, c’est l’inter-subjectivité, sans exclusive, n’importe qui peut entrer dans le jeu. Passer le test de l’acide, c’est entrer dans la danse et tous les passants sont invités, artistes et zonards, jeunes à la dérive et beaux gosses de la côte, jeunes filles de « bonne famille » ou débarquant de nulle part, jusqu’aux Hells Angels que les Merry Prankers accueillent avec une pancarte de quatre mètres de haut : « Bienvenue aux Hells Angels ». Bienvenue ? Nous, lecteurs avertis, ne manquons pas de frémir, d’autant que Tom Wolfe, journaliste embarqué volontaire, entretient le suspens : les soirées des Hells Angels, arrosées de bière et d’amphétamines, se terminent toujours mal, bastons, viols et violences, qui, très régulièrement « font venir les flics ».
Mais en 1965, les Merry Prankers sont en pleine euphorie. Tels les chevaliers de la légende, sans peur et sans reproche, ils sont sûrs d’eux, sûrs du test de l’Acide qui peut embarquer tous ceux qui savent être là, ici et maintenant. C’est Ken Kesey qui les a invités. Ken Kesey est un peu le metteur en scène du Film. La mise en scène est minimale, Ken Kesey marque les scansions, mais se garde bien d’écrire le scénario. Les personnages n’obéissent qu’à eux-mêmes, et c’est précisément parce qu’il sait reconnaître « la sauvagerie neuronale » qu’il tient lieu de chef d’orchestre. Il l’a montré dans un très beau livre, « Vol au-dessus d’un nid de coucou », publié en 1962. Dans son roman, l’histoire est racontée par un vieil Indien, officiellement schizophrène, surnommé par dérision « chef-balai » et ce vieux fou voit au travers des rôles sociaux les correspondances secrètes que révèlent des coïncidences.
Seuls ceux qui vivent aux marges du système peuvent voir au-delà des rouages qui emprisonnent l’esprit. Les Angels sont des hors-la-loi, ils sont synchros avec eux-mêmes, ils peuvent passer le test. Le LSD qu’ils ne connaissent pas a un effet étrange sur eux : ils sont aussi calmes que de petits enfants fascinés par leur premier dessin animé. La fête a duré deux jours, les Merry Prankers ont pu embarquer les Angels dans leur film parce que les uns et les autres vivent au présent la vérité de ce qu’ils ressentent. Il n’y a pas de mode d’emploi au test de l’Acide, pas de rituel, pas de guide. La perception ne peut être qu’instantanée. Ici et maintenant, la révolution psychédélique est en marche.
L’utopie messianique diabolisée
Car il s’agit bien d’une révolution. Timothy Leary, « le pape de l’acide », l’avait annoncée : « La politique de l’extase » doit « changer la conscience de l’Homme » et la tâche est urgente. « Faire éclater les huit millions de tête de New York », tel est le programme de la révolution moléculaire (Leary 1979). Cet enthousiasme prosélyte fait sourire, quand il ne fait pas peur. Ne serait-il pas la marque de l’emprise de la drogue sur le cerveau ? Ceux qui des années trente aux années cinquante avaient découvert les plantes « qui font les yeux émerveillés » ont eu le sentiment de vivre une révélation d’ordre mystique, une aventure spirituelle qui exige une initiation. Tant que l’aventure reste individuelle, elle intrigue plus qu’elle n’inquiète. Dès que l’aventure devient collective, le produit engendre « une panique morale » à l’origine de son interdit (Becker, al1985). Cette transformation d’une drogue réservée à une élite en une drogue de masse se fait par étape. Le processus de laïcisation qui accompagne la démocratisation du produit commence avec Aldous Huxley : « Les portes de la perception » ouvrent à un nouveau mode de connaissance de la vie psychique (Huxley, 1979).
Pourquoi faudrait-il que ces méthodes d’expansion de l’esprit soient réservées à une élite ? Persuadé que ces drogues de l’avenir vont développer les potentialités du cerveau humain, Timothy Leary, professeur de psychologie à Harvard, entreprend de diffuser cette expérience spirituelle dans le corps social, mais l’expérience lui a appris qu’il fallait un cadre qui ritualise la prise de produit. Avec la création de la Fédération Internationale pour la Liberté Intérieure (International Fédération for Internal Freedom), il invente une liturgie. Dans sa ferme de Milbrook, il initie au voyage une élite intellectuelle et artistique, mais en 1965, il refuse de recevoir les Merry Prankers : ces bohémiens rebelles à toute autorité l’inquiètent. Mais il est déjà trop tard. Les Merry Prankers distribuent largement les précieux buvards qu’Auguste Oswley Stanley fabrique en masse dans le laboratoire qu’il a créé en 1965. Ce petit-fils de sénateur est persuadé d’être un bienfaiteur de l’humanité : le laboratoire Sandoz en Suisse, qui en fabrique officiellement, ne suffit pas à répondre à la demande. L’année d’après, le LSD est devenu illégal et Oswley est devenu un trafiquant de drogues. Désormais, les laboratoires clandestins qui se créent dans différents pays occidentaux n’auront pas d’autres ambitions que de faire de l’argent. Le LSD est devenu une drogue comme les autres. Ou presque.
Comme drogue illicite, le LSD a de nombreux désavantages : on ne peut pas en prendre n’importe quand, n’importe comment, ses effets ne sont pas maîtrisables. Dans « Le Dieu venu du centaure », roman de science-fiction de Philipe K. Dick, une guerre interplanétaire oppose les tenants de deux drogues, le D-Liss ou le bonheur programmé et le K-Liss dont les cauchemars sont incontrôlables. Le D-Liss l’a emporté. Ceux qui ne recherchent que l’intensité préféreront la cocaïne ou les amphétamines. Ceux qui ont perdu pied atterriront souvent sur le matelas de l’héroïne (Bachmann, Coppel, 1989). « En 1966, il était possible de croire que l’usage des hallucinogènes ou plus précisément des lucidogènes allait, en se généralisant, transformer de fond en comble la civilisation occidentale et renverser les idoles (…) et sur leur socle, installer les statues des vrais Dieux (…). J’écris ces lignes en 1973. « La révolution psychédélique » ? Personne n’en parle plus », écrit Charles Duit (cité par Bouyxou, Delanoy 1995). 1973, c’est l’année de la crise pétrolière et l’utopie se porte de plus en plus mal. « The Times They Are a-Changing » avait annoncé Bob Dylan en 1964. Les temps ont changé effectivement, mais le changement n’a pas pris le chemin que dessinaient pour lui les premiers adeptes des drogues psychédéliques. Dès 1967, ce n’est plus la même chanson : « les salauds tiennent bien les rênes » déplore Bob Dylan dans Subterrean Homesick blues.
Cette année-là, toutes les tribus de la terre se sont donné rendez-vous dans le quartier des hippies. Haight-Asbury est ouvert à tous, les relations doivent s’établir de personne à personne, sans souci des étiquettes, jusqu’aux flics, des hommes en uniforme : ne suffirait-il pas de s’adresser à l’homme qui se cache derrière l’uniforme pour faire tomber tous les pouvoirs ? La réponse ne se fait pas attendre. Dans les campus, la répression policière est violente et elle l’est plus encore dans les ghettos. Face à l’escalade de la guerre au Viet-Nam, le mouvement alternatif se radicalise, certains prônent la lutte armée, d’autres prennent la route ou créent des communautés. À Ashbury, la foule compacte qui a envahi le quartier porte des jeans et des chemises indiennes, mais le mouvement est écrasé sous le poids des touristes et des zonards, tandis que de nouveaux entrepreneurs s’emparent de la musique pour faire des dollars. « L’utopie hippie a vécu » annoncent les médias. L’enterrement se révèle manifestement prématuré. Si le quartier Ashbury se meurt, le mouvement alternatif, porté par une créativité musicale inouïe, gagne toutes les capitales occidentales, mais au fur et à mesure qu’elle s’étend, l’utopie d’une révolution psychédélique s’enferme dans un cycle infernal. Les temps de la découverte sont euphoriques, l’enthousiasme gagne sans cesse de nouveaux adeptes, mais le chemin est chaque jour plus escarpé, les lignes de forces hostiles sont aussi bien externes qu’internes. Les enfants du flower power, harcelés par la répression, clochardisés ou dénaturés par l’exploitation commerciale, n’échappent pas aux sombres prédictions des campagnes anti-drogues. « Alice aux pays des merveilles », une seringue dans le bras, est devenue une pauvre junkie dont la fin est programmée, overdose, prison, folie.
Des comportements à risque à la réduction des risques
« Pourquoi ces jeunes se mettent-ils eux-mêmes en danger de mort ? » s’étaient demandé deux psychiatres, les Dr Marc Valleur et Aimé Charles-Nicolas à la fin des années soixante-dix. Les jeunes toxicomanes qu’ils reçoivent à l’hôpital Marmottan ne sont pas des malades psychiatriques, ils ne sont pas véritablement suicidaires, l’épreuve a une fonction initiatique. Telle l’ordalie, le jugement de Dieu, ces jeunes veulent conquérir le droit de vivre (Charles-Nicolas, Valleur, 1982). Les comportements à risque des jeunes sont devenus le lieu commun de tous les spécialistes de l’adolescence, mais en devenant hégémonique, cette grille de lecture laisse dans l’ombre la signification que les acteurs donnent eux-mêmes à leur conduite. Or, les sociologues de l’école de Chicago l’ont montré, comprendre les phénomènes sociaux exige de donner la parole à leurs acteurs (Chapoulie, 2001).
Sans doute certains cherchent avant tout à se mettre à l’épreuve ou à impressionner les copains, mais consommer une drogue, faire du saut à l’élastique ou avoir des relations sexuelles sans préservatif répondent à des motivations bien spécifiques. Pour ce qui concerne les drogues, l’interprétation en termes de prise de risque ne permet pas de comprendre, ni les principes qui président au choix d’un type d’usage, ni le passage d’un type de consommation à un autre qui n’est pas une succession aléatoire de mode. L’évolution du contexte social est un des déterminants du changement. Les punks sont l’envers d’une société de plus en plus individualiste, de plus en plus dominée par la recherche du profit. Les effets du produit sont un autre déterminant des changements de consommation qui se font sur la base de l’expérience acquise. Lorsque les premiers hippies abandonnent la consommation de LSD pour se réfugier dans l’héroïne, de l’extérieur, il semble que la prise de risque s’exacerbe. C’est négliger que la consommation de l’héroïne colmate les brèches ouvertes par l’irruption d’un inconscient qui peut être vécu comme le plus grand des risques ; c’est négliger aussi que l’expérience de la dépendance à l’héroïne est limitée. De même, les punks qui consommaient essentiellement bière et amphétamines ont d’abord refusé la passivité mortelle de leurs ainés héroïnomanes. Nombre d’entre eux finiront par adopter l’usage d’héroïne pour contrer les effets indésirables des amphétamines. Le cycle, qui commence par les polyusages de drogues récréativeset qui se poursuit avec des drogues stimulantes pour aboutir aux drogues anesthésiantes, s’est répété à plusieurs reprises, dans différents contextes. Il se construit sur la base de l’expérience qui comprend à la fois les effets recherchés et les effets indésirables. Malheureusement, la transmission de l’expérience d’unusager à l’autre est limitée. De plus, l’expérience ne se transmet pas d’un territoire à l’autre.
Lorsqu’en 1973, Norman Zinberg entreprend d’étudier l’usage contrôlé des drogues illicites, il est à la recherche d’une stratégie de prévention fondée sur la réalité des pratiques de protection des consommateurs (Zinberg, 1984). Nombre d’ethnographes américains, souvent affiliés à l’école de Chicago, avaient déjà décrit l’usage de drogues dans son contexte (Ogien, 2000). Du travail pionnier de Lindesmith publié en 1947, il retient les trois facteurs explicatifs de l’usage de drogues : le produit (drug), l’équation personnelle (set) et le contexte social (setting) (Lindesmith, 1947). Il retient aussi le questionnement des recherches anthropologiques : comment vivre au quotidien en consommant des drogues ? Comment éviter « les sanctions » les plus extrêmes telles que la prison, la maladie ou la mort ? Consommer des drogues implique un apprentissage qui permet de maîtriser les risques immédiats. Le cannabis est la drogue illicite la plus consommée précisément parce qu’elle est la moins dangereuse. Moins dangereuse ne signifie pas sans danger. Howard Becker, sociologue de la déviance a décrit comment, dans le milieu du jazz des années cinquante, le consommateur apprenait à maîtriser les effets du produit, en appréciant les changements de perception et en évitant les sensations désagréables (Becker, b. 1985). Lorsque l’usage se banalise, l’initiation devient minimale, dans la mesure où les consommateurs sont sensés avoir acquis une connaissance des effets du produit. Or, nombre de jeunes ont accès au produit sans en maîtriser le mode d’emploi. S’ils ne font confiance qu’à leur expérience, c’est que l’information officielle n’est pas crédible. Mieux vaudrait apprendre à ces jeunes à consommer à moindre risque plutôt que de les envoyer en prison.
En 1984, lorsque Zinberg publie son travail, la guerre à la drogue l’a emportée : la prévention se limite au « non à la drogue ». Apprendre à consommer à moindre risque est considéré comme incitatif. Et pourtant, deux événements vont contribuer à renouveler cette approche pragmatique, la menace du sida d’abord, puis l’avènement du mouvement techno. Il n’y aurait pas eu de politique de réduction des risques si une étude n’avait montré dès 1985 que 60% des héroïnomanes de rue à New York avaient spontanément renoncé au partage des seringues (Des Jarlais, Friedman, 1987). Renforcer les pratiques spontanées de protection, tel est le principe de cette nouvelle approche, mais le rôle central de l’usager est passé sous silence. Adoptée au nom de l’urgence de santé publique face au sida, la politique de réduction des risques se résume à des outils destinés aux héroïnomanes avec ses traitements de substitution et ses seringues. De même, il n’y aurait pas eu de mouvement techno si l’ecstasy n’avait eu la réputation d’être « safe », c’est-à-dire sans risques majeurs. La démarche de réduction des risques est constitutive de ce mouvement qui, avec la transe, recherche toujours la concentration des énergies, mais qui prend toutes les précautions pour éviter les dérives de la première génération. Ces précautions sont celles des usagers « succesful » qui évitent les sanctions les plus extrêmes en se soumettant à des normes protectrices. Zinberg les résume en quelques mots : le bon produit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Contrairement à la génération précédente qui n’accordait aucune confiance à l’information officielle, ces nouveaux usagers s’informent des effets du produit et veulent être sûrs de sa qualité. Le bon moment, c’est la fête où il est possible d’échapper aux conditionnements de la vie sociale ordinaire. L’usage se veut festif, ce qui le différencie de l’usage toxicomaniaque (Fontaine, Fontana, 1996). C’est aussi rompre avec l’idéologie messianique de la révolution. Le produit, associé aux loisirs, se laïcise, il perd son aura maléfique. Désormais, l’extase collective est à la portée de tous.
Un processus continu de démocratisation.
Des années cinquante à aujourd’hui, l’usage de drogue n’a cessé de se démocratiser et ce processus ne se limite pas aux produits : il est lié à la construction de nouvelles identités collectives. Les artistes beatniks des années cinquante prônaient l’exploration de l’espace intérieur, la quête d’émotions esthétiques, la recherche de l’authenticité, la liberté du nomadisme. Portées internationalement par la musique, ces valeurs de la marge se démocratisent. De la naissance du jazz aux grands concerts rock, « les frontières entre la bohême et le monde conventionnel tendent à se dissoudre ». La démocratisation de l’usage de drogues est aussi « une démocratisation de la bohème » (Mignon, 1991).
Les artistes des années cinquante fuyaient la société triomphante des Babbits, des humains standardisés par la machine industrielle, leur voyage était strictement individuel. Ni William Burroughs, ni Jack Kerouac ou Allen Ginsberg n’imaginaient que les enfants de « Mr Jones », « Monsieur tout le monde », allaient en masse dans les « be-in » ou « love-in » communier collectivement sous l’emprise du LSD, avec les musiciens de la côte Ouest, les Grateful Dead, les Doors, Jefferson Aiplane, Janis Joplin, Jimmy Hendricks, Ravi Shankar, Led Zeppelin, Zappa, Santana, Joe Cocker auxquels font écho les Beatles, les Rolling Stones, les Pink Floyd et tant d’autres. Avant d’être portée par des produits, « la politique de l’extase » est portée par la diffusion internationale de musiques populaires qui vont engendrer une myriade de sous-cultures, creuset de nouvelles identités collectives. Avant eux, les beatniks avaient puisé aux sources du jazz où Michel Leiris voyait « un signe de ralliement, un étendard orgiaque aux couleurs du moment. Il agissait magiquement et son mode d’influence peut être comparé à une possession. C’était le meilleur élément pour donner le vrai sens à ces fêtes, un sens religieux, avec communion par la danse, l’érotisme latent ou manifesté et la boisson, moyen le plus efficace pour niveler le fossé qui sépare les individus les uns des autres » (Leiris, 1939). Voilà qu’une génération après l’autre, les jeunes occidentaux se transforment en sauvages. Pris de boisson ou de drogue, voilà qu’ils sont pris d’une étrange frénésie qui, semble-t-il, ne connaît pas de limite.
« La révolution psychédélique » n’est qu’une des formes des mouvements de la jeunesse qui agitent l’Occident depuis près de cinquante ans, mais c’est une étrange aventure. Elle a terrorisé l’Amérique et, bien au-delà, a ébranlé tous les pays occidentaux. Oui, ces jeunes ont été pris de folie, oui, ils ont cru qu’ils détenaient la clé du paradis ; ils ont même cru avec Jerry Rubin, un des leaders du mouvement alternatif, que le pouvoir des « pigs », les puissants qui nous gouvernent, allait s’écrouler de lui-même en versant du LSD dans les canalisations d’eau de Los Angeles : tous sous drogue allaient fraterniser et découvrir le pouvoir de l’Amour ! Alors que les trente glorieuses touchent à la fin, l’air du temps est plus sombre, l’individualisme s’exacerbe. Les dérives contribuent à la disqualification des hippies devenus de pauvres « babas cool », dérisoires ou même grotesques. Au cours des années soixante-dix, le rapport aux drogues change, l’usage se fait fonctionnel, les drogues peuvent servir à tenir le coup, faire la fête toute la nuit, retourner au travail le lendemain, supporter les aléas de la vie. Et pourtant, ni les freaks ni les punks ne renoncent aux fêtes collectives qui associent drogues et musiques. Une génération après l’autre, les usagers cherchent à modifier leur état de conscience, qu’ils aspirent à un soulagement immédiat, à se construire une identité personnelle ou à inventer une nouvelle façon de vivre ensemble. Dans les sociétés traditionnelles, les drogues qui modifient l’état de conscience assumaient une fonction de passage de la vie quotidienne à la cérémonie rituelle, de la puberté à l’âge d’homme, de la mission de berger à celle du guerrier, ou pour le shaman, de la société des hommes à celle des esprits (Van Gennep, 1909) . Elles assument cette même fonction dans les sociétés modernes, mais à l’exception de l’alcool, cette fonction de passage n’est pas ritualisée.
Plus les changements sont rapides et brutaux, plus les consommations de drogues ou d’alcool se généralisent, et plus elles sont anarchiques et violentes. Même ces excès ont un sens. Il faut parfois aller jusqu’à s’oublier soi-même pour s’inventer une nouvelle identité : Tuer le vieil homme ! Les cris et imprécations d’Antonin Artaud retentissent avec ses « messages révolutionnaires » qui appelaient à faire « des ressuscités » qui « échappent aux vices de l’esprit de l’Europe » (note 8) , en quête d’une vie de l’esprit qui échappe aux contraintes des normes sociales. Les mouvements sociaux de la fin des années soixante étaient contestataires, mais ils répondent aussi aux exigences d’une société de plus en plus individualiste qui impose à chacun de se définir lui-même (Erhenberg, 1991). Pour autant, la quête n’est pas seulement individuelle. Si le mouvement techno se garde du messianisme révolutionnaire, il partage avec le mouvement psychédélique le désir de relations à l’autre plus respectueuses de chacun, plus tolérantes, plus solidaires. Les relations entre hommes et femmes sont plus égalitaires que dans la culture rock ; homosexuels et homosexuelles y ont joué un rôle pionnier. Le mouvement techno qui, à ses origines, a puisé dans la musique noire, s’affirme solidaire des minorités ethniques. Il refuse en outre d’exclure les marginaux et les jeunes à la dérive. Est-ce là où le bât blesse ? Ces dernières années, le mouvement a été confronté aux débordements qui ont emporté la génération de la fin des années soixante. Sans doute était-il illusoire d’espérer que la fête collective surmonte les obstacles engendrés par la précarité et l’exclusion des jeunes, par les abus de drogue et le trafic inhérent à la prohibition, et enfin par une répression policière au service d’une société qui se ferme sur elle-même. Tel le phénix, l’utopie d’une société plus démocratique, plus libre et plus joyeuse, renaît sans cesse de ses cendres. Heureusement !
Bibliographie
- ARTAUD Antonin, « Messages révoltionnaires », trois conférences prononcées à l’Université de Mexico, 1936, in Antonin ARTAUD, OEuvres, Quarto Gallimard, p. 691 et p.701.
- BACHMANN Christian et COPPEL Anne, Le Dragon domestique, Deux siècles de relations étranges entre l’Occident et la drogue, Paris, Albin Michel, 1989.
- BECKER Howard, a “Les entrepreneurs de morale”, Outsiders, Paris, Métailié, 1985.pp 64-82 ; b “Comment on devient un fumeur de marijuana”, op. Cit. Pp171- 187.
- BOUYXOU Jean-Pierre et DELANOY Pierre, L’Aventure Hippie, Paris, Editions du Lézard, 1995.
- CHAPOULIE Jean-Michel, LaTradition sociologique de Chicago, Paris, Seuil, 2001.
- CHARLES-NICOLAS Aimé et VALLEUR Marc, « Les conduites ordaliques », dans Olievenstein Claude (dir.), La vie du toxicomane, Paris, PUF, 1982.
- DES JARLAIS Don C. and FRIEDMAN Samuel, “HIV infectious amoung intravenous drug users, Epidemiology and risk reduction”, AIDS, 1,1987, 67-76.
- DICK Philipe K., « Le Dieu venu du centaure », Opta, 1969 . réed. J’ai lu, Paris, 1982.
- EHRENBERG Alain, Le culte de la performance, Paris, Calmann-Levy, 1991.
- FONTAINE Astrid et FONTANA Caroline, Raver, Paris, Anthropos, 1996.
- KESEY Ken, Vol au-dessus d’un nid de coucou, 1968.
- HUXLEY Aldous., Les portes de la perception, Paris, Editions du Rocher, 1979.
- LEARY Timothy, La politique de l’extase, Paris, Fayard, 1979.p. 81
- LEIRIS Michel, L’Age d’Homme, Paris, Gallimard, 1939. Livre de poche, p.185
- LINDESMITH A.R., Addiction and Opiate, Chicago, Adline, 1947.
- MIGNON Patrick, « Drogues, jazz et pop musique, La démocratisation de la bohème », dans Ehrenberg Alain (dir.), Individus sous influence, Drogues, alcools, médicaments psychotropes, Paris, Editions Esprit, 1991, p. 103-122. p. 106
- OGIEN Albert, « Sociologie de la déviance et usages de drogues, une contribution de la sociologie américaine », Documents du Groupement de recherche psychotropes, politique et société, n°5, avril-Juin, 2000 pp 64.
- ROUHIER Alexandre La plante qui fait les yeux émerveillés, Le PEYOLT suivi des plantes divinatoires, Guy Tredaniel Editions de la Maisnie, 1989, première édition 1926.
- VAN GENNEP Anorld, Les rites de passage : étude systématique …, Paris, E. Nourry, rééd. 1981.
- WOLFE Tom, Acid Test, Paris, Seuil, 1975.p. 17
- ZINBERG Norman E., Drug, Set, and Setting: the Basis for Controlled Intoxicant Use, New Haven, Yale University Press, 1984.